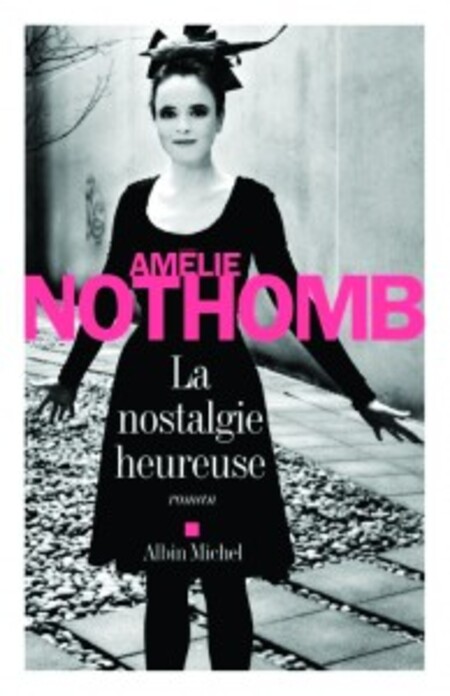-
Par Frawsy le 12 Septembre 2013 à 19:56
La nostalgie heureuse
d’Amélie Nothomb
Sur les traces du passé de la célèbre écrivaine.
3 sept. 2013 par Monique Roy de la revue Chatelaine
Vingt-troisième livre d’Amélie Nothomb. En mars 2012, après 16 années d’absence, l’écrivaine est retournée au Japon, pays où elle est née et qui lui a inspiré l’extraordinaire Stupeur et tremblements.
L’amorce
Une chaîne de télévision française propose à Amélie Nothomb un reportage sur les traces de son passé. On la filmera avec des personnes qui l’ont marquée. Sa nounou, Nishio-san, sa seconde mère, qu’elle a dû quitter, le cœur brisé, à l’âge de cinq ans. Rinri, le fiancé de ses 20 ans, qu’elle a abandonné sans explications – histoire qu’elle raconte dans Ni d’Ève ni d’Adam. On visitera les lieux de sa jeunesse : l’école maternelle d’où elle s’échappait pour courir à la maison, détruite lors du tsunami de mars 2011 ; le cimetière où, avec son amoureux, elle admirait les cerisiers en fleurs ; Kyoto, ville mythique métamorphosée en cité moderne.
Les thèmes
Premières années d’enfance, fondatrices. Premières joies et premières douleurs, indélébiles. Péril des retrouvailles ravivant les deuils. Confrontation risquée avec les souvenirs.
Les points forts
« Ce que l’on a vécu laisse dans la poitrine une musique : c’est elle qu’on s’efforce d’entendre à travers le récit. » Ce récit sans aucune fausse note, où une femme de 44 ans observe la petite fille de 5 ans et la jeune femme de 22 ans qu’elle a été. Étonnante, émouvante et sage Amélie Nothomb qui, « avec les moyens du langage », signe un superbe livre de nostalgie heureuse. Albin Michel, 162 pages.
Pour lire un passage exclusif de notre livre du mois : La nostalgie heureuse
10/04/2005. L'ecrivain Amelie Nothomb rentre au Musee Grevin.
Amélie Nothomb
Naissance au Japon en 1967. Famille appartenant à l’aristocratie belge, père ambassadeur, grand-oncle écrivain. À cinq ans, celle qui a longtemps cru qu’elle était nippone doit quitter ce pays pour suivre ses parents diplomates. La Chine, New York, le Bangladesh, la Birmanie, le Laos. À 17 ans, elle rentre à Bruxelles, où elle obtient l’agrégation en philologie romane. À l’adolescence, elle souffre d’anorexie et commence à écrire. Elle confiera dans une entrevue que l’écriture lui a sauvé la vie. En 1992, Hygiène de l’assassin, son premier roman, cause une onde de choc (tirage : 385 000 exemplaires). Qui est donc cette écrivaine singulière ? On l’apprendra au fil des ans puisque, depuis, chaque rentrée littéraire présente un nouvel opus de cette fille étrange qui porte des chapeaux extravagants, tient un discours brillant parfois incompréhensible, a mangé des fruits blets à la télévision… Elle a ses fidèles – dans plus de 30 pays – qui la suivent même quand elle s’égare dans des voies nébuleuses et qui se délectent de ses petits bijoux, certains autobiographiques, comme Stupeur et tremblements – Grand Prix de l’Académie française, adapté au cinéma par Alain Corneau –, Le sabotage amoureux, Métaphysique des tubes et Biographie de la faim.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Frawsy le 12 Septembre 2013 à 15:05
Trois livres pour cuisiner la rentrée
Par Andréanne Chevalier
Métro
Alors que la rentrée commence et que les récoltes foisonnent, Métro a déniché trois livres de recettes parfaits pour passer un automne rempli de bonne bouffe.

Des repas en famille simplifiés
La comédienne – et fille de restauratrice – Marie-Joanne Boucher s’adresse ici aux parents qui veulent simplifier les moments des repas. Elle y insère de nombreux trucs et astuces à mettre en pratique pour mieux gérer son temps et sa cuisine. Très facile d’accès, réaliste et ludique – l’indicateur du temps de vaisselle à faire en fait foi –, on n’y propose pas des plats pour impressionner, mais plutôt pour bien manger tous les jours.
On a aimé : Ce livre s’adresse aussi aux gens pressés pour qui les soupers et les collations sont un défi quotidien.
On a moins aimé : Des recettes parfois trop simples!
Petites et grandes fourchettes, Marie-Joanne Boucher, photos de Dominique Lafond. Éditions Transcontinental. En libraire.

Tout savoir sur les légumes
Premier tome d’une nouvelle série encyclopédique, Tout sur les légumes est à la fois un volume de référence et un livre de plus de 130 recettes. Le feuilleter permet d’explorer une imposante quantité de légumes (divisés en catégories; par exemple, les légumes feuilles, les légumes racines, les tubercules) et d’apprendre sur leurs valeurs nutritives, leurs utilisations, leur entreposage et leur sélection.
On a aimé : C’est une mine d’informations et plusieurs variétés de légumes sont présentées.
On a moins aimé : Des dessins au lieu de photos pour certaines illustrations qui donnent un aspect vieillot.
Tout sur les légumes, Éditions Québec Amérique avec L’Académie culinaire et l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF). En librairie.

À la découverte d’un ingrédient incontournable
Après Les gourmandises d’Isa et Pomme, Isabelle Lambert s’est consacrée au citron. Une idée qu’on trouve excellente, puisque que cet agrume n’a pas son pareil pour rehausser les plats et qu’il est incontournable dans une cuisine – ou carrément, dans une maison!
On a aimé : Les recettes simples d’exécution.
On a moins aimé : Il n’y a pas d’indicateur du temps requis pour la préparation et pour la cuisson de la recette, sauf si on la lit au complet; une lacune côté pratico-pratique.
Citron, Isabelle Lambert. Éditions Modus Vivendi. En librairie. Lancement officiel du livre à la Librairie gourmande du Marché Jean-Talon, le 7 septembre, de 11 h à 13 h.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Frawsy le 10 Septembre 2013 à 00:04
Le polar du mois : Le fils emprunté
Jean-François Bérubé Photographe
Enquête sur un meurtre aussi horrible qu’étrange.
8 sept. 2013 Par Chrystine Brouillet de la revue Chatelaine
Jérôme Marceau, directeur aux Homicides, enquête sur un meurtre aussi horrible qu’étrange : un homme a subi le supplice du pneu enflammé. Dans le hangar où il a été immolé, des indices montrent qu’il y a eu plusieurs témoins. Qui sont-ils ? Qui a choisi ce mode d’exécution ? Vengeance ? Crime rituel ? Marceau fouille l’univers du vaudou tout en tentant de retrouver un équilibre personnel. Il croit y parvenir en aidant Gabriel, jeune homme épris de vengeance… Mais ce fils emprunté lui réserve des surprises. Un roman haletant qui nous balade dans les souterrains de Montréal. On adore Jérôme Marceau, parce qu’il doute et aime un peu trop faire cavalier seul. Et parce que ses rapports avec Gabriel nous poussent à nous interroger sur le sens du mot paternité… Une œuvre solide, avec cet enquêteur qui s’affirme dans le paysage du roman policier québécois.
Par Jacques Savoie, Expression noire, 336 pages.
Bravo ! Chrystine Brouillet a remporté en mai le prix Tenebris du polar québécois s’étant le plus vendu en 2012 pour La chasse est ouverte, 30 000 exemplaires en format papier seulement.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Frawsy le 22 Août 2013 à 19:46
Pourquoi moi?
Le premier chapitre du livre de Lise Ravary.
5 mar. 2013 Par Jean-Yves Girard de la revue Chatelaine
Lise Ravary a été rédactrice en chef et éditrice de Châtelaine de 2001 à 2009. Celles et ceux qui la connaissent – et qui ont travaillé avec elle – le savent : c’est une femme exceptionnelle, exigeante, extravagante, excessive en tout. Lise a vécu plusieurs vies, a atteint des sommets, a souvent trébuché en route, mais s’est toujours relevée. Elle l’a expliqué, il y a quelques mois, avec sa franchise habituelle à Richard Martineau aux Francs-tireurs. Aujourd’hui chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal, elle publie son premier livre. Une sorte de biographie, où cette Québécoise élevée dans le catholicisme raconte comment et pourquoi elle a embrassé la religion juive. Et se fait notre guide pour un aller-retour dans l’univers fascinant - et déroutant - des Juifs hassidiques.
Pourquoi moi? Ma vie chez les Juifs hassidiques
Par Lise Ravary
Éditions Libre Expression
Extrait :
Chapitre 1 : Le coup de foudre
Je suis à Jérusalem ! Toute ma vie, j’ai rêvé de voir Jérusalem, la ville d’or. Yerushalayim shel zahav. Le soleil fait mine de s’écraser sur la cité de David, en ce vendredi veille de sabbat. On dit erev shabbat, dans la langue hébraïque, apprendrai-je plus tard. Une journée marquée d’une grande frénésie avant que ne s’impose le repos du septième jour. Shabbat shalom, la paix du sabbat. Mon premier voyage en Israël s’achève, nous repartons dimanche. Les avions d’El Al, les lignes aériennes israéliennes ne volent pas le samedi. C’est tant mieux car samedi, je serai malade comme un chien, enfermée dans ma luxueuse suite de l’hôtel historique King David. Mais ça, je ne le sais pas encore.
Au Moyen Âge, on croyait que la Terre sainte était le centre du monde, et Jérusalem, le centre du centre. C’est sous la coupole dorée du monument islamique qui domine la ville, le Dôme du Rocher, que se trouve la Pierre de fondation, le nombril du monde à partir duquel Dieu aurait créé la Terre, selon les textes sacrés juifs, chrétiens et musulmans. À lire les journaux d’aujourd’hui, rien n’a changé. Aucun autre pays de huit millions d’habitants ne génère autant de colonnes d’encre dans les journaux et d’images à la télévision. Mais à ce moment-là, je ne savais pas non plus qu’Israël, son peuple et son Dieu deviendraient le centre de ma vie.
J’étais venue en Israël pour mon travail de journaliste. Je remplaçais une collègue tombée malade à quelques jours du départ. J’allais me joindre à deux autres journalistes canadiennes : Sara, de Toronto, et Tracy, de Vancouver. Notre mission ? Découvrir la gastronomie israélienne – oui, ça existe ! Pas vraiment mon domaine d’expertise, mais je me disais que j’aurais sans doute l’occasion de m’échapper pour aller flairer d’autres sujets plus substantiels. À Gaza ou en Cisjordanie, par exemple. Mais la veille de notre départ, un extrémiste juif a abattu 29 musulmans en prière et en a blessé 125 autres au tombeau des Patriarches, lieu de sépulture pré- sumé de Sara, femme d’Abraham, à Machpelah, près d’Hébron, en plein cœur des territoires pales- tiniens. J’étais certaine que le voyage serait annulé, mais non. Le représentant du gouvernement israé- lien nous a dit : « Chez nous, la vie continue.» Mais il était bouleversé. Un Juif qui se dit pieux ne tue pas des gens en prière. Cela va à l’encontre de toutes les croyances. Le pays était choqué jusqu’à la moelle.
Les territoires ont été bouclés pendant toute la durée du voyage, à cause de la violence qui a suivi la tuerie. Les Palestiniens étaient révoltés, avec raison. Je n’ai pas pu m’y rendre, moi qui espérais prendre le pouls, voir de mes yeux vivre les femmes palestiniennes, les enfants et les vieillards. J’ai remis ça à un autre voyage. Je savais que je reviendrais en Israël, dont j’étais devenue amoureuse dès les premiers instants à l’aéroport international David-Ben-Gourion. Mais qui aurait cru que j’allais aussi tomber amoureuse du judaïsme et surtout du hassidisme ?
Sara, une de mes compagnes de voyage, s’en est doutée dès les premiers jours.
Ce récit n’est pas un guide touristique d’Israël. Ni un outil de promotion pour un peuple ou une religion. Je raconte seulement mon histoire juive à moi, la seule que je connaisse.
Il existe en Israël, comme à Florence, une étrange maladie qui fait perdre la boule à des touristes autrement sains d’esprit et qui se prennent tout à coup pour le roi David, Jésus, Mahomet ou Léonard de Vinci. Le seul remède connu : le patient doit quitter l’endroit qui le perturbe pour redevenir lui-même. Sans autre forme de traitement. Les psychiatres appellent cela « le syndrome de Jérusalem ». À Florence, on parle de « syndrome de Stendhal ». À Jérusalem, le célèbre hôpital Hadassah consacre une aile psychiatrique à cette étrange maladie, le Kfar Shaul Mental Health Center. La clientèle ne manque pas, me dit-on.
Je sais que je n’ai pas été frappée par le syndrome de Jérusalem. Ce qui m’est arrivé est aussi réel, aussi concret que les pierres du mur des Lamentations, là où ma vie a basculé. Ça ne pouvait être le syndrome de Jérusalem parce que mon état ne s’est pas amélioré quand je suis revenue à Montréal. Il s’est accentué.
À ce jour, je ne comprends pas ce qui m’est arrivé. Ce qui s’est passé en moi. Comment une Québécoise de souche, née à Montréal-Est, ayant grandi dans Hochelaga-Maisonneuve, éduquée chez les Franciscaines et les sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, divorcée, mère de deux filles, Ingrid et Devon, qui gagne sa vie comme journaliste depuis l’âge de seize ans et dont la devise est « Le doute est ma seule religion », comment donc quelqu’un comme moi pouvait-il ressentir l’appel d’une tradition plusieurs fois millénaire dont j’ignorais à peu près tout ?
Depuis vingt ans, je me pose les trois mêmes questions : pourquoi moi ? Pourquoi ça ? Pourquoi maintenant ?
Écrire ce récit va peut-être m’aider à trouver enfin la réponse, deux décennies après ma rencontre avec le judaïsme. Mais j’en doute. Rien dans ma vie n’a été aussi étrange et peu de choses ont été aussi vraies.
Retournons à Jérusalem, en ce vendredi après- midi du printemps de 1993. Je viens d’avoir trente- sept ans. Et j’ai terminé ma première année de sobriété. Finie, la cocaïne dont je me servais pour contrôler une dépression chronique. J’étais passée à un cheveu de la mort. Ma vie reprenait son cours. Du bout des doigts, je touchais enfin au bonheur pour la première fois depuis très longtemps. Mes problèmes s’aplanissaient, un à un. Les rédacteurs en chef recommençaient à me confier des reportages. Je me rapprochais de mes filles. Je n’avais pas beaucoup d’argent, mais de bons amis venaient déposer des sacs d’épicerie devant ma porte et payer mon loyer quand j’étais fauchée. Je recommençais ma vie à zéro.
Quand j’ai su que je partais en Israël, je me suis dit que j’irais peut-être à la rencontre de ma foi chrétienne, mise au rancart à l’âge de douze ans. Dans les mouvements anonymes que je fréquentais alors, on nous suggérait de confier nos vies à une « puissance supérieure » de notre choix. Pas évident pour quelqu’un qui, comme moi, doutait très fort de l’existence d’un dieu. Mais la vérité, c’est qu’à ce moment de ma vie, j’avais l’esprit plus ouvert qu’à l’habitude.
Pendant ce voyage de dix jours, nous avons visité tous les lieux historiques de la Terre sainte chrétienne : le mont des Béatitudes, la mer de Galilée, Nazareth, que nous avons dû quitter précipitamment quand une volée de pierres s’est abattue sur nous, Bethléem, le mont des Oliviers, l’étrange église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Des monastères centenaires, des églises encore plus anciennes. Dans ce pays, les panneaux de circulation se lisent comme la Bible. Nazareth 15 km. Jérusalem 32 km. Tout était merveilleux, magique, beau à pleurer – quels paysages ! –, mais je n’ai pas retrouvé ma foi de couventine.
Oded, notre guide, avait gardé pour la fin la visite du mur des Lamentations, dont le vrai nom est « mur occidental », ou Kotel en hébreu – les Israéliens détestent qu’on l’appelle mur des Lamentations, une expression inventée par les Britanniques quand ils se sont vus confier la Palestine au lendemain de la Première Guerre mondiale. Après le lunch, nous sommes partis à pied de l’hôtel, Sara, Oded et moi, en direction du secteur juif de la Vieille Ville de Jérusalem. De 1948, année de la création de l’État d’Israël, jusqu’à la guerre des Six Jours, en 1967, l’accès à cette partie de la ville était interdit aux Juifs, qui ne pouvaient donc prier au Mur, le lieu le plus saint du judaïsme, car il se trouvait sur un territoire contrôlé par la Jordanie voisine. Jérusalem, à cette époque, était coupée en deux.
Le Mur, qui soutient la partie ouest de l’esplanade des mosquées pour les musulmans, qui la contrôlent, ou esplanade du temple pour les Juifs, est une immense synagogue à ciel ouvert. Des milliers de fidèles s’y pressent jour et nuit, foulant la très belle esplanade du Kotel, un espace moderne imaginé par l’architecte israélo-canadien Moshe Safdie, concepteur d’Habitat 67 et du Musée des beaux-arts de Montréal. À gauche, quand on fait face au Mur, la section longue de 48 mètres réservée aux hommes. À droite, la section des femmes qui s’étend sur 12 mètres seulement. Aujourd’hui, les sexes sont séparés, mais des photos de la fin du xixe siècle montrent les hommes et les femmes priant côte à côte.
On vient au Kotel pour célébrer anniversaires, mariages, bar- et bat-mitsvah, ces cérémonies qui confirment le passage à l’âge adulte, à treize ans pour les garçons et à douze ans pour les filles. Le judaïsme reconnaît que les filles atteignent la maturité avant les garçons.
Si le judaïsme orthodoxe reconnaît aux femmes des qualités spirituelles que les hommes n’ont pas – on dit qu’elles sont plus proches de Dieu –, ce n’est pas un phare dans l’histoire de l’émancipation féminine pour autant.
À témoin, tous les mois, à la nouvelle lune, des féministes israéliennes, les Femmes du Mur, viennent prier au Kotel à la manière des hommes. Depuis vingt-trois ans, elles manifestent pour obtenir le droit de porter des châles de prière et des kippas, et de faire la lecture de la Torah à haute voix. Des choses interdites aux femmes, affirment les rabbins haredim, un mot hébreu qui veut dire « craignant Dieu » et qui désigne les ultra- orthodoxes en Israël. Chaque mois, ces femmes courageuses se font injurier, bousculer, cracher dessus et même lancer des chaises. Elles sont arrêtées par la police du Kotel sur l’ordre des autorités religieuses. Elles sont emmenées au poste de police pour la nuit et, comme punition, on leur interdit de se rendre au Kotel pendant des semaines, voire des mois. Il arrive qu’elles se fassent coller des amendes pouvant atteindre 5 000 shekels, ou 1 300 dollars, et cela en dépit de décisions de la Cour suprême, qui leur reconnaît le droit à l’égalité et à la liberté religieuse. Ce n’est pas pour rien qu’elles ne sont jamais accusées de méfait. Elles ne font rien d’illégal. C’est de l’intimidation pure et simple.
Nous nous tenions à une centaine de mètres du Mur. J’ai demandé à Oded si je pouvais m’approcher pour y déposer ma prière, même si je n’étais pas juive. Il a ri en me disant qu’il y avait accompagné Hillary Clinton quelques jours auparavant. Je me suis dirigée vers le Mur, regardant bien droit devant moi, tous mes sens en alerte, hyper consciente de me tenir dans un lieu historique et spirituel millénaire, exceptionnel. J’avais écrit une prière pour mes filles sur un bout de papier que je voulais glisser entre les pierres du Mur, selon la tradition.
Le Talmud, ce complément de la Torah qui regroupe toutes les lois juives et l’ensemble de leurs interprétations rabbiniques, aussi appelé « la loi orale », enseigne que toutes les prières du monde transitent par Jérusalem avant de prendre le chemin du ciel. Et que la présence divine est plus concentrée au Mur que n’importe où sur terre.
Quand les prières finissent par joncher le sol, des rabbins les ramassent et les enterrent en récitant des prières spéciales. Puisque le nom de Dieu est inscrit sur la plupart de ces bouts de papier, la loi juive interdit de les jeter ou de les faire brûler.
Rien de plus cristallin en moi que le souvenir de ce moment. Je me revois, marchant vers le Mur comme si j’étais attirée par un puissant aimant. Dans ma tête, une émotion étonnante faisait son chemin vers ma conscience : « Enfin chez moi, enfin à la maison.» Jusqu’à ce que mon cerveau d’ordi- naire cartésien reprenne le dessus et chuchote à mon oreille : « Es-tu en train de devenir folle ? C’est pas chez toi ici.» Peine perdue. J’avais l’impression, au plus profond de cette âme dont je niais l’existence depuis si longtemps, que j’étais enfin arrivée chez moi, à la maison. Que tous les pas que j’avais posés dans ma vie m’avaient menée jusqu’ici. À Jérusalem, au Kotel. En cette veille de sabbat. Cette maison m’était pourtant inconnue, elle était peut- être même habitée par des êtres hostiles. Mais plus j’avançais, plus je devenais sereine. Une grande paix m’a enveloppée, tel un châle de lumière, une fois arrivée au pied du Mur. J’ai étendu les bras pour l’étreindre. Des cyclamens roses poussaient entre les pierres, des prières végétales. Des milliers de petits morceaux de papier, tous porteurs de l’espoir d’une vie meilleure, s’accrochaient au Mur avec la force du condamné. En haut, sur l’esplanade du temple, de jeunes Arabes nous narguaient. À cette époque, le vendredi, jour de prière pour les musulmans, de fréquentes pluies de pierres s’abattaient sur les visiteurs au Mur. Tout un contraste.
Je ne me souviens plus très bien de ce qui s’est passé après. J’ai pleuré, beaucoup, fort, longtemps. J’ai pleuré d’avoir préféré les paradis artificiels à ma famille pendant tant d’années. Pleuré pour Ingrid et Devon. Pleuré pour ma mère naturelle, qui m’a abandonnée quand j’avais trois mois. Pleuré pour ma mère adoptive, morte à cinquante- six ans, quand j’avais dix-neuf ans, et avec qui je ne m’étais pas réconciliée. Pleuré pour la sécheresse de mon âme. Pleuré pour le vide spirituel dans ma vie, malgré tous mes succès professionnels. Et je crois que j’ai aussi pleuré de bonheur, même si je ne comprenais pas pourquoi j’entendais «enfin chez moi » dans ma tête.
Je suis restée là jusqu’à la tombée du jour. Quand je suis retournée à l’hôtel King David, le sabbat était commencé. Mes collègues étaient rentrés depuis longtemps. Quand j’ai regagné ma suite, la femme de chambre avait placé sur la table de chevet une petite carte pour me souhaiter Shabbat shalom. Que la paix du sabbat soit avec vous. La ville venait de s’assoupir pour vingt-cinq heures, en souvenir du septième jour de la création du monde, le jour du repos choisi par Dieu.
Je me suis changée et je suis allée rejoindre mes amis pour dîner au American Colony Hotel, un établissement historique situé dans la partie arabe de Jérusalem. L’hôtel où descendent traditionnellement les correspondants des médias du monde entier. En ce soir de sabbat, c’était le meilleur endroit pour bien manger. Le vendredi soir et le samedi, la Jérusalem juive, pieuse, s’endort. Presque tout est fermé. À Tel Aviv la laïque, 30 kilomètres plus loin, c’est tout le contraire : la fête ne fait que commencer. Tel Aviv, c’est un autre monde, tout aussi juif, mais tonitruant, décomplexé, cosmopolite, hédoniste, laïc à la limite de l’antireligieux et ultramoderne.
Pendant le repas, je me suis confiée à Sara. J’ai essayé de lui raconter du mieux que je le pouvais ce qui m’était arrivé. Sara, l’épouse d’un grand acteur canadien aujourd’hui décédé, est juive mais non pratiquante, quoique très attachée aux traditions. Comme la majorité des Juifs en Amérique du Nord. Elle s’est mise à rire, j’ai cru qu’elle se moquait de moi. Pas du tout. Elle m’a rappelé un incident de l’avant-veille que mon cerveau embrouillé avait déjà oublié. Nous étions à la boutique du musée d’Israël. J’adore les boutiques de musées. On y trouve les plus beaux souvenirs de voyage. J’hésitais devant tous ces trésors quand Sara m’a tendu un petit coffret noir et argent contenant les cinq livres de l’Ancien Testament, ce que les Juifs appellent la Torah. C’est ce que le judaïsme a de plus précieux. La base de tout. Les mystiques juifs, les kabbalistes, croient que la Torah est le plan de l’Univers. «Te souviens- tu de ce que je t’ai dit à ce moment ? » insista-t-elle.
« Euh, non.» Je n’avais pas vraiment porté atten- tion. Je t’ai dit en te la donnant : « Un jour, tu seras juive.» «Tu as dit ça?»
J’entendais le thème musical d’Au-delà du réel dans ma tête.
Quand je me suis réveillée, le lendemain matin, j’étais malade comme la mort. Fiévreuse, je grelottais sous mes couvertures. Ma tête était sur le point d’exploser. Je me suis rarement sentie aussi mal qu’à ce moment. On a fait venir un médecin. Pas évident de trouver un médecin le samedi à Jérusalem ! La plupart se reposent avec leur famille. Pas besoin d’être pratiquant pour marquer le sabbat. En Israël, c’est le seul jour complet de repos de la semaine. Le dimanche, tout le monde retourne au travail ou à l’école. Les gens de l’hôtel m’ont dit de ne pas m’inquiéter. La loi juive ordonne de briser le sabbat en cas de maladie grave. Mais était-ce grave ?
Vers le début de l’après-midi, un jeune médecin, fin de la vingtaine, a frappé à ma porte. Il portait la kippa, ce petit couvre-chef des Juifs pieux, en version crochetée, qui identifie un Juif nationaliste sioniste religieux. Un Juif des colonies, autrement dit. En Israël, on peut connaître l’affiliation religieuse d’un homme par le type de kippa qu’il porte sur sa tête. Les ultra-orthodoxes, ou haredim, portent des grosses kippot en velours noir. Le médecin m’a examinée sans rien trouver de grave. Un méchant virus, sans doute. « Mais je ne sais pas si vous pourrez voyager demain », me dit-il. Chouette, ai-je pensé, je vais pouvoir rester plus longtemps. Peut-être assez longtemps pour comprendre ce qui m’est arrivé.
Avant de partir, il m’a parlé un peu de lui. Natif de Toronto, il avait émigré en Israël avec sa femme et ses enfants quelques années auparavant. « J’habite une colonie en Judée », le terme qu’utilisent les Juifs pieux pour décrire une des deux parties de la Cisjordanie. Judée et Samarie sont les noms bibliques de ces territoires maintenant palestiniens. « Je viens de Kiryat Arba, en banlieue d’Hébron, la ville où est enterré Baruch Goldstein », me dit-il avec un air de dédain. « C’est ma femme qui voulait qu’on s’installe là au lieu de vivre en Israël comme tel. Les maisons ne sont pas chères dans les colonies. Oui, je suis pratiquant, mais je ne suis pas un fanatique. Je ne crois pas qu’Israël doive contrôler les territoires palestiniens. Ils ont droit à leur pays. S’il vous plaît, croyez-moi. On dit tant de mal de nous. Si j’avais été un fanatique religieux, je ne serais pas venu vous soigner aujourd’hui, car vous n’êtes pas juive.» Il m’a laissé son numéro de téléphone. J’aurais voulu l’interviewer plus tard, mais j’ai perdu ce numéro.
Dimanche, malheureusement, je me sentais beaucoup mieux. Assez pour envisager douze heures d’avion sur El Al, y compris une escale de nuit à Amsterdam, tout ça en classe économique. Voyager sur El Al, c’est du sport. Des hommes prient dans les allées, des enfants courent partout, les agents de bord engueulent les passagers qui gueulent de leur côté, tout le monde veut un surclassement en première… Pour une religion aussi stricte, l’âme juive s’accommode très bien du désordre. La discipline et l’ordre ne sont pas les caractéristiques premières du peuple israélien, foncièrement méditerranéen. Mais la persévérance et l’effort, ça oui !
À l’aéroport, en attendant notre vol, je suis tombée par hasard, si une telle chose existe, sur une brochure intitulée Comment on devient juif. À vrai dire, je ne savais même pas qu’on pouvait devenir juif. Je croyais qu’on l’était de naissance ou en épousant un Juif, comme l’avaient fait Marilyn Monroe, qui avait épousé le dramaturge Henry Miller, et Elizabeth Taylor, devenue Mme Eddie Fisher. Ou encore notre ch’ti préféré, l’acteur français Dany Boon, né de père kabyle, mais qui s’est converti au judaïsme pour l’amour de sa douce.
Le contenu de la brochure m’a sciée en deux. On y expliquait qu’avant de se convertir, le Juif en devenir doit étudier pendant de nombreuses années. Si c’est un homme non circoncis, il doit passer au bistouri. Il faut apprendre l’hébreu, une langue qui n’a pas le même alphabet que la nôtre et qui se lit dans le sens inverse, comme l’arabe. Le candidat à la conversion doit habiter un quartier juif, être vu à la synagogue tous les samedis, passer le sabbat et les innombrables fêtes juives avec une famille pieuse. Il doit aussi manger casher et respecter les 613 lois juives ainsi que les traditions et coutumes qui les accompagnent. Il ou elle ne doit d’aucune façon fréquenter ou épouser un Juif avant d’être converti selon la loi. Le candidat doit aussi subir un examen oral administré par un tribunal composé de trois rabbins très pieux ainsi qu’un examen écrit. À cette étape, il est prêt pour l’immersion rituelle dans un mikvah, une sorte de petite piscine alimentée à l’eau de pluie où les femmes vont se « purifier » après leurs règles. Lieu aussi où l’on doit faire tremper ustensiles et couverts neufs avant de s’en servir. Tout, dans le judaïsme, doit être consacré à Dieu. Consacré fou raide, oui, me suis-je dit. On oublie ça tout de suite.
J’ai relu la brochure au moins trois fois, incrédule.
Dix jours en Israël ? Je me sentais comme si j’avais passé dix jours dans une laveuse, au cycle spin.
Bonne Lecture
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Frawsy le 12 Août 2013 à 20:48
Marilyn : sa dernière scène
Un livre de sa dernière séance photo avec le photographe Bert Stern.
9 août. 2013 Par Jean-Yves Girard de la revue Chatelaine
Photo: Studio Rogers
Le décès récent d’un homme de 83 ans a fait surgir le fantôme de Marilyn Monroe, encore.
Juin 1962. Le magazine Vogue demande à Bert Stern, jeune photographe prometteur, de croquer le minois de la pulpeuse blonde. En trois jours, il prendra 2 500 photos. Au début, elle joue la star, son meilleur rôle. Dom Pérignon aidant, elle pose nue (« Pas mal pour 36 ans, non ? » lui lance-t-elle), puis laisse tomber le masque, se dévoile comme jamais, vulnérable, blessée, seule. Elle a droit de regard sur le choix final et trace un X sur les clichés qu’elle n’aime pas. Six semaines plus tard, elle est retrouvée dans son lit. Morte. Nue. Et seule.
The Last Sitting
Photos de Bert Stern
Textes de Norman Mailer.
Bonne lecture...
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
La Tigresse au coeur tendre







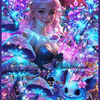














 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot