-
Par Frawsy le 25 Octobre 2017 à 13:40
#MoiAussi: au-delà des vedettes…
#MoiAussi a accompli ce qu’#AgressionNonDénoncée n’avait pas permis de faire: démontrer l’ampleur du problème du harcèlement sexuel.
Marilyse Hamelin du magazine ChâtelaineLa preuve n’est plus à faire quant à l’utilité de la campagne #MoiAussi (#MeToo) sur les réseaux sociaux. Au moment où j’écris ces lignes, les gestes de plusieurs hommes influents ont été dénoncés. La vague #MoiAussi, c’est une prise de conscience collective assortie de gestes d’éducation populaire, comme un guide pour démystifier les agressions et le harcèlement sexuel au travail, publié par Le Journal de Montréal.
Ainsi, #MoiAussi a accompli ce qu’#AgressionNonDénoncée n’avait pas permis de faire: démontrer l’ampleur du problème du harcèlement sexuel. Si l’affaire Aubut a été une forme de prologue, cette fois, on sent que ça ne passe plus.
Mais au-delà du «déboulonnage de vedettes», bien avant que La Presse ne publie son enquête sur Éric Salvail, j’avais déjà pu mesurer l’utilité de la campagne en raison de la prise de conscience de nombreux hommes «ordinaires». Certains ont publiquement utilisé les mots-clics #ihave #itwasme ou #ididit sur les réseaux sociaux. D’autres sont tour à tour débarqués dans ma boîte de réception privée sur Facebook, au point où j’ai dû dire à chacun qu’il n’était «pas le seul à passer à la confesse».
Qu’ils aient eux-mêmes commis du harcèlement sexuel par le passé ou qu’ils en aient été les témoins silencieux, ces hommes-là ont non seulement compris quelque chose grâce à #MoiAussi, mais ils ont senti le besoin d’exprimer des regrets. Ce n’est pas rien.
Mieux vaut tard…Sur une note plus personnelle, j’ai reçu des excuses de la part d’un homme qui était au courant du harcèlement sexuel que j’ai subi en emploi au tournant des années 2010 et qui ne m’en avait jamais parlé.
Évidemment, son message a ravivé chez moi de douloureux souvenirs, enfouis. Je n’ai jamais été aussi dysfonctionnelle et incompétente que durant ces mois passés à endurer les agissements et paroles déplacées de mon ex-patron à mon endroit. À cette époque, je suis allée chez la coututière à quelques reprises pour faire ajouter des boutons aux cols de mes chemisiers et me suis mise à porter des foulards et des pulls amples. La jeune femme naïve que j’étais a cru que cela pourrait la protéger.
(Âmes sensibles, s’abstenir de lire le paragraphe suivant, qui relate ce que j’ai vécu.)
Je me souviens de ma surprise la première fois où, en route vers une réunion, en voiture, mon patron m’interroge sur mes positions préférées au lit. Ces questions reviendront à plusieurs reprises durant les mois suivants. Je me souviens du sentiment de peur qui s’installe chez moi à l’idée de me retrouver seule avec lui au bureau, parce qu’il arrive souvent par derrière, au moment où je m’y attends le moins, pour me susurrer des paroles à l’oreille ou pour renifler l’odeur de ma nuque. Je me souviens de sa manière de m’enlacer par la taille, de mettre sa main sur le creux de mes reins lorsque je suis à l’ordinateur, de sa façon de me regarder dans les yeux et de mimer un cunnilingus avec ses doigts et sa langue, alors que sa conjointe est dans la même pièce, de dos. Je me souviens de sa manière de me faire sentir que je suis son employée et que je lui appartiens. Je me souviens de mes collègues et supérieurs – à qui je me plains de la situation – qui relativisent ce que je vis («Il fait ça pour rire»; «Il est comme ça, que veux-tu»; «Ignore-le»).
J’ai fini par démissionner. Je me suis arrangée, toute seule.
Je n’attendais plus rien, après toutes ces années… J’ai d’abord versé quelques larmes en lisant ce message d’excuses, mais il m’a fait grand bien. C’est également ça, la vague #MoiAussi.
Évolution des mentalitésJe comprends, en tout respect, celles qui sont à la fois lasses et en colère, qui ne voient aucune utilité à ce mouvement à long terme, mais il ne faut pas céder au cynisme ou au découragement. Les changements de mentalité sont une chose difficile à quantifier. Or c’est souvent à l’aune de ceux-ci qu’on mesure l’évolution des sociétés.
Dans son livre Le féminisme québécois raconté à Camille, l’historienne Micheline Dumont rappelle que le 12 mai 1982, la première fois qu’il a été question à la Chambre des communes de la violence faite au femmes, ces messieurs parlementaires ont éclaté de rire. Il faut dire qu’à l’époque, l’air du temps faisant en sorte que certains se sentaient bien à l’aise de parodier une vieille annonce de bière (Labatt, n’y a rien qui la batte!), en lançant à la cantonade, suivi d’un gros rire gras: À place de la battre, débouche-toi donc une Labatt! Hilarant, n’est-ce pas?
De nos jours, grâce à une législation plus adaptée, mais aussi au travail de fond des groupes de femmes et aux campagnes publiques de sensibilisation, la violence conjugale n’est plus acceptable socialement. (D’ailleurs, je me souviens comme si c’était hier de cette publicité qui a marqué mon enfance.)
Bien que le problème du harcèlement sexuel ne disparaîtra pas comme par magie, nous venons de faire un sapré pas en avant sur cette question. Ce n’est plus aux victimes de ressentir de la honte et de la culpabilité. Non seulement les fautifs devront réfléchir, mais j’ose espérer que les témoins ne se tairont plus.
Je sais, j’espère beaucoup, mais on avance, indéniablement. Et il faut continuer, parce que le monde, on est vraiment en train de le changer.
Chroniqueuse du moisJournaliste indépendante, conférencière et auteure, Marilyse Hamelin dirige le blogue féministe La semaine rose. Son premier essai, Maternité, la face cachée du sexisme, vient tout juste de sortir en librairie.
Note de Frawsy:
N'ayez pas peur de dénoncer ces
agressions sexuelles au Service de Police.
-
Par Frawsy le 4 Octobre 2017 à 14:28
Ingrid Falaise: la vie après l’enfer de
la violence conjugale
L’auteure et comédienne Ingrid Falaise raconte, dans «Le Monstre – la suite», le long processus de reconstruction qu’elle a dû traverser après avoir fui un mari violent et manipulateur.
Andréanne Moreau du magazine Châtelaine
Photo: Stéphanie Lefebvre
«Oui, il y a un lendemain après la violence amoureuse. Oui, des ailes, ça repousse.» L’auteure et comédienne Ingrid Falaise raconte, dans Le Monstre – la suite, le long processus de reconstruction qu’elle a dû traverser après avoir fui un mari violent et manipulateur.
Ingrid a épousé «M» en 2000. Ce n’est qu’une fois séquestrée dans un petit appartement de Saint-Laurent, persuadée qu’il allait la tuer, qu’elle a réussi à fuir pour de bon, après deux ans de tortures physiques et mentales.
Elle a beau avoir quitté son bourreau il y a maintenant 15 ans, elle porte encore les marques de ses agressions. Les conséquences de la violence conjugale ne s’arrêtent pas au moment où l’on choisit de partir.
«On ne peut pas simplement tourner la page et recommencer notre vie où on l’avait laissée», soutient-elle. Les cauchemars, la peur constante, les flashbacks subsistent.
Pour tenter d’estomper la douleur, Ingrid s’est jetée tour à tour dans la drogue, le travail et l’automutilation. Finalement, après différentes thérapies et des rencontres salvatrices, la dernière grande étape de sa guérison aura été l’écriture de son premier livre, Le Monstre, il y a deux ans.
«C’est comme si, en racontant mon histoire, j’avais réussi à faire en sorte qu’elle ne m’appartienne plus, indique-t-elle. Depuis que je l’ai écrite, j’ai arrêté de faire des cauchemars et je marche la tête haute. Je ne suis plus du tout la même personne.»
Sauver des viesLa pénible épreuve qu’a vécue Ingrid n’aura toutefois pas été vaine. Depuis qu’elle l’a rendue publique, elle reçoit en effet des témoignages de centaines de femmes qui ont trouvé le courage de partir.
«L’une d’elles m’a envoyé une photo de son fils en me disant que c’était grâce à moi s’il était vivant. Son mari lui donnait des coups dans le ventre alors qu’elle était enceinte et elle l’a quitté après m’avoir vue à Tout le monde en parle», relate la comédienne.
Dans ces messages, on lui demandait souvent comment elle avait fait pour regagner sa confiance en elle-même et aller de nouveau vers les autres.
«C’était beaucoup trop long à expliquer pour que je puisse répondre à chaque personne. Alors, je me suis dit que je devais absolument écrire la suite», raconte-t-elle.
Elle espère que cette deuxième partie de son récit pourra aider quiconque a déjà vécu une expérience traumatisante, quelle qu’elle soit, à s’en sortir. «On a tous une reconstruction à faire. On passe par des chemins différents, mais qui se ressemblent beaucoup.»
Faire mieuxChaque fois qu’un drame conjugal est médiatisé, Ingrid Falaise constate qu’il reste beaucoup à accomplir pour sortir les femmes des griffes de leurs monstres. «Ça me vire à l’envers parce qu’elles sont comme moi. J’ai réussi ma fuite, pas elles.» Elle insiste: les victimes de violence conjugale ne sont ni faibles ni sottes.
«Parmi les femmes qui me contactent, il y a des avocates, des policières, des travailleuses sociales… Elles ont honte d’être tombées dans le panneau et cette honte les isole encore davantage. Il faut qu’elles comprennent que ce qu’elles vivent n’est pas un signe de faiblesse. Ce n’est pas leur faute», insiste-t-elle.
«Dire à une victime qu’elle n’a qu’à quitter son conjoint, c’est aussi ridicule que de dire à une anorexique qu’elle n’a qu’à manger, illustre-t-elle. Ces femmes traversent une réelle peine d’amour. Il est dans leur esprit à chaque instant.»
Les organismes comme SOS violence conjugale, dont elle est porte-parole, peuvent être d’un grand secours pour les victimes comme pour les proches qui désirent les aider à s’en sortir.
Ingrid souhaiterait que l’État réinvestisse dans une grande campagne pour sensibiliser à la violence conjugale, tant physique que verbale. «Les mots font plus mal que les coups de poing», soutient-elle.
Malgré tout, malgré la douleur qui refait surface quand elle observe les cicatrices sur ses jambes, Ingrid Falaise s’est reconstruite. Elle a fait face à ses démons, elle a pu relancer sa carrière d’actrice et aimer encore. Son nouveau conjoint, Cédrik, qu’elle a rencontré peu avant de commencer l’écriture de son premier livre en 2014, connaît ses blessures et l’accepte telle qu’elle est.
Elle attend maintenant avec impatience l’arrivée de leur enfant, qui devrait naître d’ici quatre à cinq semaines, en espérant de tout cœur que son bonheur puisse servir d’exemple à toutes celles qui se remettent d’une relation toxique.
-
Par Frawsy le 3 Octobre 2017 à 16:46
Angela Merkel: politicienne hors jeu
Les résultats des récentes élections en Allemagne ont dérouté avec l’entrée en force de l’extrême droite au Parlement fédéral, une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, Angela Merkel a été réélue chancelière – elle est toujours la femme la plus puissante du monde.
Josée Boileau du magazine Châtelaine
Photo: Christian Liewig/ABACA/INSTARimages.com
Angela Merkel est une personnalité politique à part. Pas parce qu’elle est une femme, mais parce que si l’on dresse le portrait-robot du parfait politicien, elle a tout simplement tout faux!
Elle n’a ni charisme, ni sens de la répartie, ni talent pour les discours. Elle n’a aucune flamboyance: ni bas à la Justin Trudeau ni souliers remarqués comme chez la première ministre britannique Theresa May. Le goût du luxe? Même pas, elle se meuble chez Ikea. Elle vient du monde scientifique; elle décide lentement; elle fuit les médias; elle ne flatte pas l’électorat…
À qui la comparer? À un Stephen Harper? Mais elle est bien plus pragmatique que lui et elle ne s’emporte pas derrière les portes closes. De même, elle est encore plus ordinaire que le Français François Hollande, qui a voulu être un «président normal»; plus cérébrale que notre premier ministre Philippe Couillard; et plus discrète sur sa vie privée que l’ensemble des dirigeants réunis. Comme femme politique, elle est certes aussi forte qu’une Margaret Thatcher, sauf qu’elle n’est pas une guerrière.
Bref, elle est politiquement hors jeu avant même d’entrer dans le jeu. Et pourtant, elle est chancelière de la puissante Allemagne depuis 12 ans, réélue le 24 septembre dernier pour les quatre années qui viennent.
Ces élections, qui rebrassent en profondeur le Bundestag, sont pour elle un camouflet politique, a-t-on pu lire partout. Mais cela n’a pas entamé le respect personnel à son égard, qui la classe parmi les grands dirigeants de notre temps. C’est vrai tant dans son pays – où on l’appelle Mutti (maman) – que sur la scène internationale, particulièrement depuis l’élection de l’erratique président américain Donald Trump qui a consolidé son statut de politicienne repère.
Tout cela donne un personnage fascinant à décortiquer, comme l’a fait la journaliste Marion Van Renterghem, longtemps reporter au quotidien français Le Monde, dans une courte biographie arrivée au Québec en septembre: Angela Merkel. Un destin (éditions Édito).
Marion Van Renterghem explique très bien les ingrédients qui font une Angela Merkel. Une Allemande née à l’Est, sous le communisme, mais avec un père pasteur, donc en porte-à-faux avec l’idéal prôné par le régime. Elle a ainsi appris à être à part d’un système tout en en faisant partie.
Après la chute du mur de Berlin en 1989, ce ne fut dès lors pas un choc pour elle de se retrouver rare protestante au sein du CDU (Union chrétienne-démocrate), parti que dominent des catholiques, de même que femme, divorcée et sans enfants, aux côtés d’hommes très traditionnels. Pas besoin de pousser pour le changement, sa seule présence fait la différence.
Ses politiques sont de la même eau: on y chercherait en vain l’envie de révolution. Angela Merkel est plutôt à l’image de l’Allemagne. Obsédée, comme sa société, de rigueur financière, donc sans concession aux pires heures de la crise grecque. Mais marquée par l’histoire de son pays, ce qui explique pourquoi en 2015, elle a accueilli des centaines de milliers de réfugiés syriens qui affluaient vers l’Europe – un geste dont on dit aujourd’hui qu’il a été à double tranchant puisqu’il aurait favorisé la montée de l’extrême droite.
Mais l’Allemagne n’étant pas un pays féministe, Angela Merkel, pas plus que les Allemandes, ne se réclame de cette étiquette. La vie des mères au travail a d’ailleurs été longtemps extrêmement compliquée en Allemagne de l’Ouest. Jusqu’en 1977, les femmes devaient même demander la permission de leur mari pour travailler! Et le calendrier scolaire était organisé en tenant pour acquis que maman restait à la maison. Pas étonnant qu’encore aujourd’hui les patronnes y soient rares – et quand on en trouve, elles n’ont pas d’enfants.
La situation s’est améliorée ces dernières années, notamment grâce à l’ouverture de garderies. Mais c’est dû au programme du Parti social-démocrate (SPD), qui formait une coalition avec le CDU. Angela Merkel n’a, de son côté, jamais rien promis aux femmes.
Pourtant, elle est un symbole de réussite au féminin, et c’est pourquoi ce sont surtout les petites anecdotes rapportées par Marion Van Renterghem qui ont attiré mon attention.
Ainsi, le clan rapproché d’Angela Merkel est composé de deux femmes, avec qui elle forme un trio d’inséparables depuis 20 ans. Ça leur donne une force de frappe, mais ça agace! J’ai aussitôt pensé au duo composé de l’ancienne première ministre Pauline Marois et de sa chef de cabinet Nicole Stafford, complices depuis la fin des années 1970. Pour elles aussi, que de critiques à leur égard, bien davantage que lorsque ce sont des hommes qui sont ainsi soudés.
De même, si Angela Merkel n’est pas une femme qui séduit, elle a joué d’une arme typiquement féminine pour faire sa place: un autodénigrement… parfaitement contrôlé. De quoi monter les échelons sans qu’on la voie venir. Quoi, déjà rendue là «la gamine», comme la surnommait le chancelier Helmut Kohl! Hep, faut bien qu’une femme s’organise si elle veut se faufiler!
Elle doit d’ailleurs son entrée en politique, en 1990, à une autre arme: une discrimination positive qui ne dit pas son nom – Helmut Kohl avait besoin d’une femme pour assumer le ministère de la Condition féminine! Quelle ironie, étant donné le peu d’intérêt d’Angela pour ces questions. Mais c’est aussi la démonstration parfaite que l’obligation de trouver permet de recruter des femmes formidables (vive les quotas, quoi!).
J’ai bien souri aussi quand j’ai lu qu’Angela Merkel était une minutieuse absolue, le genre qui, dans les rencontres internationales, oblige ses homologues à discuter de la moindre virgule d’un texte commun à signer. Elle doit les rendre fous, et in petto s’en amuser, ces messieurs que la gloire fait davantage carburer que le souci bien féminin du détail… Mais vu la stature de la dame, ils n’osent pas protester, et Mutti, l’air de rien, s’assure de contrôler le mot de la fin.
Et c’est ainsi que, pendant qu’Hillary Clinton panse ses blessures, Angela Merkel apparaît toujours comme indélogeable. Des leçons à tirer?
-
Par Frawsy le 27 Août 2017 à 18:07
Rudolf Noureev (1938 - 1993)
Danser pour être libre
du site Herodote.net
Comment Rudi, un petit garçon tatare tombé amoureux de la danse, a-t-il réussi à construire un destin hors du commun et devenir Rudolf Noureev, l’une des personnalités les plus douées mais aussi les plus énigmatiques de son temps ?
Pour comprendre cet homme lumineux mais insupportable, d’un talent exceptionnel mais totalement fantasque, un détour s'impose à travers le parcours et la personnalité de celui qui se cachait derrière le masque du Tsar de la danse.
Isabelle GrégorL'enfant du train
Il fait un froid glacial en cette fin d'hiver 1938, du côté du lac Baïkal, et le train qui emporte Farida Nureyeva vers son mari n'est guère chauffé. Drôle d'endroit pour accoucher ! C'est pourtant là, dans le Transsibérien, que Rudolf Noureev va se faire remarquer pour la première fois en venant au monde le 17 mars. Plus tard il aimera voir dans cette apparition peu banale le symbole caché du nomadisme incontrôlable qui marquera toute son existence.
En attendant, le voilà enfin installé au chaud avec ses trois sœurs dans la maison de Vladivostok où vit son père Hamet, militaire chargé de l'enseignement de l'histoire du pays et de la bonne parole communiste.
C'est un homme rude au physique trapu et aux yeux bridés, héritage de ses ancêtres, les guerriers musulmans tatars.
Très vite, après avoir emmené sa famille à Moscou, il doit l'abandonner pour intégrer l'Armée rouge et défendre le pays contre le Reich. Les années difficiles commencent pour Farida qui préfère revenir sur ses terres natales, du côté des monts Oural. La situation n'y est pourtant guère réjouissante : elle peine à nourrir ses enfants qui sont traités de clochards par leurs camarades de classe.
Rudolf, en particulier, est l'objet de moqueries dues non à sa belle réussite en cours mais à son caractère solitaire et renfrogné. Pour oublier son surnom d'Adolf, le jeune garçon s'isole encore plus, ne trouvant de réconfort que dans la musique déversée par le transistor de sa mère.
Et puis un jour, c'est le choc : à son école est organisée une démonstration de danses folkloriques. Quelle révélation ! Quel plaisir d'aller dans les hôpitaux faire quelques pas pour soulager les soldats blessés ! Farida a bien compris que son Rudik n'aime rien tant que la musique, et elle va remuer ciel et terre pour emmener toute sa petite famille à l'opéra de sa ville, Oufa.
Qu'importe qu'elle n'ait pu payer qu'une seule place ! Dans la cohue, tous parviennent à se glisser à l'intérieur de la salle pour vivre un moment qui marquera à vie le petit passionné : « J'étais possédé. J'étais appelé. En voyant les danseurs, ce soir-là, défier la gravité et s'envoler, j'ai alors eu la certitude absolue que j'étais né pour devenir danseur ». Désormais, rien ne peut l'arrêter.
Bretelles contre pommes de terreDans ses mémoires, Noureev se souvient de la faim qui a marqué son enfance :
« Nous partagions une chambre de 9 mètres carrés. Mon souvenir dominant, c'est celui de la faim, une faim constante, dévorante. Je me souviens de ces interminables hivers de 6 mois, à Oufa, sans lumière et presque sans nourriture. Je me souviens aussi de ma mère pataugeant dans la neige pour nous rapporter quelques livres de pommes de terre sur lesquelles nous devions vivre une semaine. [...] Je me rappelle certaines fois où ma mère était partie pour une de ces épuisantes expéditions en quête de quelque chose à manger et où mes sœurs et moi nous glissions dans le lit pour essayer de dormir. Nous avions vendu ou échangé contre de la nourriture tout ce que nous possédions : les vêtements civils de mon père, sa ceinture, ses bretelles, ses chaussures. Nous disions : "Le complet gris de papa est vraiment très tendre", ou bien : "Cette ceinture avait très bon goût, tu ne trouves pas ?" » (Rudolf Noureev, Autobiographie).À nous deux, le Kirov !
Pourtant, un obstacle majeur vient vite doucher son enthousiasme. Pas question en effet pour son père, de retour du front, que Rudolf devienne autre chose que médecin ou artilleur. Les coups tombent lorsque le garçon refuse d'aller à la chasse, occupation pourtant bien plus virile et honorable que de faire des pirouettes sur le parquet !
Ravalant ses pleurs, Rudik apprend à mentir, à dissimuler ses sentiments. Mais il ne peut cacher sa passion à Anna Oudeltsova, musicienne et ancienne danseuse qui va accepter de lui donner des leçons gratuites.
Très vite, il devient indispensable à la troupe de l'opéra d'Oufa où on finit par lui proposer un poste de danseur titulaire. Et puis quoi encore ! Il refuse, certain d'être destiné à entrer dans l'école de ballet de Léningrad (Saint-Pétersbourg aujourd'hui) même s'il commence à se faire vieux, du haut de ses 15 ans.
Il est sur le bon chemin puisqu'il a rejoint Moscou avec ses camarades d'Oufa et peut enfin admirer les danseurs du Bolchoï, à défaut d'être à leur place. Mais comme la bourse qui doit lui ouvrir les portes du Kirov de Léningrad (aujourd'hui théâtre Mariinski) tarde à venir, il décide de se rendre sur place en août 1955. Après trois jours d'un voyage en train cauchemardesque, le voici qui se précipite enfin à l'école du Kirov.
Portes fermées ! Le jeune ambitieux avait oublié que les danseurs aussi partent en vacances... Doté d’une obstination sans faille, il parvient à décrocher une audition mais l'accueil est plus que froid : « Jeune homme, ou bien vous deviendrez un brillant danseur ou bien vous serez un parfait raté ». On veut bien cependant lui donner sa chance, chance qu'il va s'empresser de saisir à pleines mains.
Le ballet russe, tradition et explosionChercher l'origine du ballet en Russie revient à aller à la rencontre de l’un des pères du pays : Pierre le Grand. C'est en effet lui qui, souhaitant occidentaliser sa patrie, s'attacha à y développer la danse européenne qu'il considérait comme une marque de civilisation. En 1738 sa femme, Anne, décrète donc la fondation de l'École impériale de ballet dans le Palais d'Hiver et la place sous la direction d'un maître à danser d'origine bien sûr française, Jean-Baptiste Landé. Un de ses successeurs, le Suédois Charles Didelot, arrive en 1801 pour donner une dimension romantique inédite aux spectacles en encourageant les artistes à multiplier les sauts, quitte à les attacher au plafond par des fils...
Après 1847 le Marseillais Marius Petipa poursuit son œuvre et offre au répertoire nombre de chefs-d'oeuvre dont « les trois grands », La Belle au bois dormant(1890), Casse-Noisette (1892) et Le Lac des Cygne (1895), nés de sa collaboration avec Piotr Ilitch Tchaïkovski. Ce compositeur sut se montrer particulièrement conciliant à l’égard de son acolyte de génie, le laissant régler les pas avant la musique et renvoyer les partitions lorsqu'elles ne s'accordaient pas à la chorégraphie. Mais à la fin du règne de Petipa, la révolte gronde : on veut du neuf ! C'est Serge de Diaghilev qui, rassemblant autour de lui les meilleurs artistes du théâtre Mariinski, apporte ce souffle de liberté en fondant en 1907 la compagnie des Ballets russes. Première étape : quitter le pays pour rejoindre la France.
Le Paris de la Belle Époque fait un triomphe à ces audacieux qui, sous la direction du chorégraphe Michel Fokine, vont peu à peu s'éloigner du ballet traditionnel pour créer leur propre style. Isolés de la mère-patrie par la Première Guerre mondiale et la Révolution russe, ils vont tout changer : avec Igor Stravinsky à la partition, Vaslav Nijinski à la danse, Léon Baskt aux décors et aux costumes, c'est le sacre de la modernité ! L'Art, sur scène, se fait vivant et coloré. Les plus grands noms du monde intellectuel ne s'y trompent pas et s'empressent de proposer leur collaboration, permettant au ballet « cubiste » Parade (1917) d'être signé par Érik Satie, Jean Cocteau et Pablo Picasso.
Mais du côté de Moscou, l'arrivée au pouvoir de Staline freine toute innovation. Le Mariinski est rebaptisé Kirov en hommage à un patriote communiste, et l'on reprend le répertoire de Petipa pour bien affirmer la dextérité des étoiles locales. Le ballet soviétique est en effet devenu une vitrine du régime qui l'envoie dans de grandes tournées à travers les capitales du monde. Héritier d'une riche tradition, Noureev était appelé à se fondre dans le moule et à suivre sagement ses camarades sur les planches de Paris ou Londres. Mais avec ce tempérament de feu, rien ne pouvait se passer comme prévu.
Le vilain petit canard
« N'oublie pas que tu es ici par bonté et grâce à la charité de l'école ». Cette remarque de « Tête au Carré », de son vrai nom Chelkov, directeur de l'école, ne sera en effet pas oubliée par Noureev. Très vite, il se fait remarquer non seulement par ses cheveux trop longs et trop bruns mais surtout par son esprit rebelle qui le pousse à sortir du rang, sur et hors scène. N'a-t-il pas, une nuit, fait évacuer son dortoir pour pouvoir écouter seul de la musique ?
« Le gredin attardé » finit par être expédié devant Alexandre Pouchkine, ce professeur qui peut se targuer d'avoir été pendant 28 ans premier danseur au Kirov. Cet excellent pédagogue, d'une grande douceur, encourage le jeune homme à développer son talent en restant lui-même, c’est-à-dire exigeant, méfiant et sauvage.
Grâce à cette alliance des contraires, il devient vite le meilleur élève de l'école et se voit logiquement choisi pour la représenter au concours international de Moscou. Un choix perspicace puisqu'il reçoit le premier prix, à l'unanimité.
À vingt ans, il peut observer avec amusement le Bolchoï et le Kirov se battre pour l'intégrer comme soliste. Ce sera le Kirov, qu’il juge plus moderne et plus apte à comprendre ses propres innovations. C'est une erreur : on lui reproche de danser non plus sur quart mais sur demi-pointe très haute, on s'agace de son refus de porter des perruques, on le moque d'avoir adopté des collants non plus bouffants mais proches du corps. Quelle impudeur !
Mais le public suit et nombreuses sont les admiratrices qui inventent des subterfuges pour lui lancer des fleurs sur scène. Il fascine le pays, enchante la nomenklatura et s'habitue à être applaudi par Khrouchtchev et son entourage.
Ne voit-il pas que le milieu de la danse commence à bouillir de rage ? N’entend-il pas les avertissements : « Noureev, ta présence nous pourrit l'atmosphère... Tu es une tache noire sur le corps pur de ce ballet » ? Plus inquiétant, le Service de renseignement soviétique a repéré ses « dérives occidentalistes » et s'attache à l'envoyer en tournée à l'autre bout du pays dès que des « ennemis » de l'Ouest viennent présenter leurs spectacles.
Non dénué de ressources, le jeune homme parvient pourtant à prendre des cours d'anglais et même à rencontrer la troupe américaine de My Fair Lady. « Politiquement faillible », il est tenu à l'œil, et il le sait...
Situation : transfuge...S'il fut le plus connu, Noureev ne fut pas le seul à fuir le régime soviétique de façon quelque peu rocambolesque. Militaires et espions, champions d'échecs et patineurs artistiques… La liste des transfuges comporte quelques noms plus ou moins connus mais aucun n’est plus célèbre que celui de Staline. C’est en effet sa propre fille, Allilouieva, qui poussa en 1967 la porte de l'ambassade des États-Unis en Inde pour demander asile, laissant derrière elle ses enfants. Dans le monde de la danse, citons l'exemple de George Balanchine qui put développer les Ballets russes en France après avoir fait défection à son pays lors d'une tournée en Allemagne, en 1924. Cinquante ans plus tard c'est le danseur étoile du théâtre Mariinsky, Mikhaïl Baryschnikov, qui disparaît de la troupe du Bolchoï en représentation à Toronto avant d'annoncer qu'il ne rentrera pas en URSS. Mais c'est surtout Noureev qui restera comme l'exemple même du transfuge, tant l'épisode du Bourget a marqué les esprits. Il fut d’ailleurs le modèle de Claude Lelouch pour la fameuse scène où le danseur Jorge Donn saute par-dessus les barrières de l’aéroport pour rejoindre la liberté, dans Les Uns et les autres (1981).
« Il y a un danseur russe en bas qui veut rester en France... »
C'est en 1961 que le destin de Rudolf Noureev va se jouer. Quelques mois auparavant pourtant, on avait décidé qu'il devait payer son insubordination chronique d'une interdiction totale de se rendre à l'étranger. Fini, le rêve des tournées internationales ! Volatilisés, les triomphes à Paris, Londres puis New York ! Il ne fera pas partie de ceux qui ont pour mission officieuse d'effacer l'épisode récent de la baie des Cochons et de redorer l'image de l’URSS à coups d'envols de tutus.
Mais tout à coup on se rend compte que le danseur étoile numéro un de la troupe est beaucoup trop vieux pour éblouir le public de l’Ouest, fin connaisseur. Ouste ! Et place au fougeux Noureev ! Tout étonné, Rudolf se retrouve donc embarqué pour la France au milieu d'une troupe de 120 danseurs accompagnés d'une belle équipe de surveillance du KGB.
Ces cerbères ne parviennent cependant pas à l’empêcher de visiter Paris en compagnie de quelques homologues français qu'il a réussi à séduire, tout comme il va séduire dès sa première représentation l'ensemble des critiques qui vont le célébrer à coups de métaphores plus ou moins originales : « Le Kirov a trouvé son cosmonaute ! », « C’est le nouveau Nijinski ! », « Venez voir le Tsar en chaussons ! »…
Mais les dîners au champagne et les fêtes chez Régine commencent à irriter sérieusement le KGB qui piaffe en attendant la fin du séjour parisien. Enfin, le 16 juin 1961, la troupe se présente à l'aéroport, direction Londres. Tout le monde est nerveux, à commencer par Rudolf qui craint qu'on lui réserve un vol sans escale vers la mère-patrie. Effectivement, le directeur du groupe vient lui annoncer qu'il voyagera à part, dans quelques jours, mais qu’il doit faire d’abord une représentation au Kremlin.
Le piège est tellement grossier que Noureev se précipite pour demander à ses amis français de prévenir au plus vite Clara Saint, une jeune femme avec qui il s'est lié d'amitié et qui connaît André Malraux. Arrivée rapidement sur place, elle lui conseille d'aller se refugier auprès de deux policiers français qui, selon la convention de Genève, doivent assistance à toute personne demandant expressément asile.
« I want to stay here ! I want to stay here ! » (« Je veux rester ici ! ») s'écrit alors Noureev en se jetant dans les bras des policiers après avoir effectué « le saut le plus long et le plus époustouflant de toute [s]a carrière ». À lui la liberté !
L'envolDans son Autobiographie, Noureev revient sur l'épisode de l'aéroport du Bourget :
« Dans la vie, il faut parfois savoir prendre une décision en un éclair, sans avoir eu le temps d’y penser, sans avoir eu le temps de peser le pour et le contre. J’ai souvent connu cela en dansant, lorsque sur scène quelque chose se passe mal. C’est aussi ce qui m’est arrivé par un chaud matin de juin 1961, dans la banlieue de Paris, à l’aéroport du Bourget, alors que l’ombre du gros Tupolev qui devait me ramener à Moscou s’étendait sur moi.
Cette aile immense me menaçait, telle la main du magicien diabolique du Lac des cygnes. Devais-je me soumettre et essayer d'en tirer le meilleur parti possible ? Ou, comme l'héroïne du ballet, devais-je défier l'ordre pour accomplir une dangereuse – voire fatale – tentative d'évasion ?
J'avais senti la menace monter durant tout mon séjour à Paris comme un oiseau pris dans un filet aux mailles de plus en plus fines.
Or un oiseau doit pouvoir voler, comme un jeune artiste doit pouvoir parcourir le monde : pour comparer, assimiler et enrichir son art par de nouvelles expériences. Cela contribue autant à son développement qu'à celui de son pays. Un oiseau doit pouvoir voyager, découvrir le jardin du voisin et ce qui s'étend au-delà des collines, puis revenir chez lui pour enrichir la vie des siens par le récit de celle des autres et par une vision élargie de son art. C'est ce que j'osais faire, et c'est pour cette raison que j'allais être expédié à Moscou [...] » (Rudolf Noureev, Autobiographie).Dame Margot et son « petit Gengis Khan »
Une nouvelle vie s'ouvre pour Noureev : condamné à 6 ans de prison par contumace dans son pays, désormais riche de ses seuls vêtements et son talent, il doit tourner la page. Heureusement, les propositions de contrat ne se font pas attendre ! On s'arrache en effet le « beau Rudik » qui fait la Une des journaux du monde entier.
Qu'importe si lui-même se refuse à toute revendication politique comme le reconnaît une fiche des Renseignements français : « Il semble que Noureev soit tout entier à son art », il est réduit par les médias de l'époque à un « saut vers la liberté », à un pied-de-nez contre le régime soviétique. Finalement, malgré les filatures plus ou moins discrètes, malgré les tentatives avortées pour le blesser et mettre fin à sa carrière, il parvient à retrouver un peu de tranquillité au sein du Ballet du marquis de Cuevas.
Désormais libre de ses choix, il se lance dans des paris osés, comme en 1965 ce ballet de Roland Petit, Le Jeune homme et la mort, où il partage la vedette avec Zizi Jeanmaire devant les caméras de télévision. Dans le même temps, pour la première fois, il connaît la passion amoureuse en croisant le chemin du danseur danois Erik Bruhn qu'il a toujours considéré comme son modèle. Mais c'est une Anglaise, Margot Fonteyn, qui devient à 42 ans sur scène le double de Noureev, à peine âgé de 23 ans.
Reine incontestée de la danse mais proche de la retraite, c'est elle qui choisit de contacter ce Tatare dont tout le monde parle. On assiste alors entre eux à un véritable coup de foudre, mais un coup de foudre artistique : malgré leurs origines totalement opposées, les deux stars parviennent à trouver dans leur art un accord parfait, comme l'a expliqué Noureev : « Nous ne formions qu'un seul corps, une seule âme […]. Ce n'est pas elle, ce n'est pas moi, c'est le but que nous poursuivons ensemble » qui serait à l'origine de cette complicité exceptionnelle.
Giselle (1962), Marguerite et Armand(1963), Le Lac des cygnes (1964) et ses 89 rappels... Pendant 17 ans, le couple va éblouir le monde de la danse et marquer de sa grâce les scènes les plus prestigieuses. Pour Margot, c'est l'occasion de relancer en beauté sa carrière tandis que Rudolf profite du carnet d'adresses très jet-set de sa partenaire. Le voici à la Maison-Blanche en train de prendre le thé avec Jackie avant d'être invité par Grâce de Monaco sur la Côte-d'Azur. Noureev a atteint son but : il est désormais une des plus grandes stars de l'époque.
Quand l'orage Noureev éclate...En 1963, Noureev enchaîne les répétitions de Marguerite et Armand aux côtés de Margot Fonteyn. A cause d'une jaquette jugée trop longue, l'ambiance n'est guère à la sérénité, comme le raconte à son ami Cecil Beaton le directeur de la communication du Royal Ballet de Londres :
« Depuis le Front Noureev.
Temps : orageux.
Dear Cecil,
Quelle journée de tempête, de rage, de drames hystériques ! […] Le ballet a commencé à 10h30 et dès sa première entrée, on savait que cela allait être joyeux... Il n'a pas tenté de danser quoi que ce soit, traita Margot abominablement, la rabroua, arracha sa chemise (la vôtre) et la jeta dans la fosse d'orchestre […], il donna une telle démonstration de mauvaises manières que l'on tremblait de peur, et nous avons disparu de sa vue dans la terreur et l'horreur à l'état pur... […] Ninette de Valois prit la parole, lui jura que personne, à Covent Garden, n'avait vendu cette histoire de costumes à la presse. […] Il esquissa un pâle sourire, on l'aida à remettre sa chemise et soudain, la tempête s'arrêta... On prit les photos. Margot était de marbre, comme si rien ne s'était passé. Il dansa soudain comme dans un rêve... le soleil était revenu ! » (cité par Ariane Dollfus dans Noureev, l’insoumis).« Rudi, we love you ! »
Mais qu'avait-il de plus ? Certes, sa défection à l'aéroport de Paris a fait beaucoup pour nourrir une légende de rebelle tournant le dos aux conventions avec un plaisir non dissimulé. Dans ces années 60 qui refusent de plus en plus le conformisme, les jeunes, pourtant peu habitués à s'intéresser à un art jugé vieillot, se reconnaissent dans cette bête de scène qui est la preuve vivante que l'on peut décider de sa vie.
On aime ses sauts d'humeur, ses caprices de diva, ses jurons plus ou moins exotiques. On pardonne à ce « Rimbaud des steppes » de frapper ses petites partenaires de ballet et de lancer son verre contre les murs en criant « Noureev ne se sert pas, on le sert ! ». Mais cette insolence faite d'un narcissisme démesuré n'explique pas tout : malgré ce caractère abominable qui lui vaut plusieurs fois de finir au poste, Noureev possède aussi un charisme qui plait aux foules, une sauvagerie dans le corps qui inquiète, une androgynie qui fascine.
À la fois puissant et fluide, il revendique qu'un « homme peut être tout aussi expressif, et aussi raffiné, sans paraître ridicule », qu'une femme. Il bouleverse totalement l'image que l'on se faisait jusqu'alors d'un danseur, simple faire-valoir jugé sur sa capacité à soulever avec grâce sa partenaire d’entrechats. Surtout, Noureev le barbare a su mieux que quiconque imposer une danse si imprégnée de sensualité que ses représentations ont été comparées à des « orgies ».
Sauvage, véritable « rock star » de la danse classique, il crée rapidement autour de son nom une véritable Rudimania qui lui vaut d'être suivi par des hordes de fans. Certains de ses « noureevniks », dit-on, auraient consacré tout leur temps libre pendant 30 ans à partager le moindre de ses déplacements ! Dandy, il a également compris l'importance de l'image et joué avec son apparence, passant de la chemise Nehru à l'ensemble en cuir, sans oublier ces bérets qu'il ne quittera plus à la fin de sa vie.
Il aime surtout mettre à son service cette presse « people » qui l'adore et lui demande de multiplier les séances photos et les enregistrements télévisés. Pour la première fois, les chaînes acceptent de retransmettre en direct des ballets, à condition que « le danseur plus-que-parfait » soit sur scène. Mais la télévision, c'est aussi pour lui une façon de redorer sa réputation et de montrer son humour, comme dans cette séquence mémorable du Muppets show où l'étoile réinvente Le Lac des cygnes au bras de Piggy la Cochonne (1977) ...
Pour celui qui reconnaissait volontiers être une « canaille », ce succès est une reconnaissance dont il se délecte pour bâtir jour après jour sa légende, l'œuvre de sa vie.
Un intrus« Où que j'aille, je suis un intrus. Je suis un intrus en Occident, un intrus dans chaque troupe. Et j'ai cette sensation-là à chaque fois que je m'introduis quelque part. Ce n'est pas agréable. Et pourtant je refuse d'être mis de côté. Je sais ce que je dois faire, je sais ce que je peux donner. J'ai une mission, et je dois la remplir » (Rudolf Noureev, interview au New York Times, 1974).
L’insatisfait
Devenu star, Noureev sait s'entourer d'avis avisés pour gérer sa carrière et sa fortune, que l'on estimera à 80 millions de dollars et qui fera de lui le danseur le plus riche du monde. Est-ce par peur du manque qu'il aime par-dessus tout accumuler, que ce soit les maisons ou les meubles anciens ? Son appartement, quai Voltaire à Paris, se transforme en caverne d'Ali Baba, miroir du luxe où il apprécie de s'enfermer entre deux tournées.
Cet homme pressé ne ralentit en effet pas le rythme des représentations, acceptant les invitations de nombreuses troupes au point de jouer un répertoire d'une centaine de rôles... Lorsque l'âge commence à se faire sentir, dans les années 70, il glisse doucement des rôles très physiques à ceux, moins exigeants, de la danse contemporaine. En 1977 il choisit même de tâter du cinéma en acceptant le rôle-titre de Valentino, expérience qu'il renouvelera en 1983 pour le thriller Exposed, sans plus de succès.
Mais les rumeurs de déclin commencent à se faire entendre : trop vieux, il est temps qu'il raccroche les chaussons ! D'ailleurs, Covent Garden n'a-t-il pas rejeté sa candidature pour diriger le Royal Ballet ? Qu'importe ! Il part pour New York mais Jack Lang le convainc de revenir à Paris en 1983 pour prendre la direction du Ballet de l'Opéra de Paris.
Il était la danse...L'hommage rendu à Noureev par son ami Mikhaïl Barychnikov est peut-être celui qui traduit le mieux la personne et l'artiste : « Il est l'un des hommes les plus attachants que je n'ai jamais rencontrés. Son appétit pour la vie et pour son travail était insatiable. Son corps et son âme étaient de parfaits véhicules d'une beauté impalpable. Il avait le charisme et la simplicité d'un homme de la terre, et l'arrogance intouchable des dieux. Entouré de millions d'êtres, il vivait la vie solitaire d'une personne complètement dévouée à son milieu, qui était la danse et uniquement la danse » (cité par Bertrand Meyer-Stabley dans Noureev).
Un « pop star dancer » chez les petits rats
Les critiques fusent mais Noureev n'en a cure et s'attache à mettre un grand coup de balai dans l'institution tricentenaire, avec sa douceur habituelle : « Vous pas parler, vous faire » ! Du côté des danseurs, les contestations montent, les retards de répétition se font plus fréquents et les conflits se multiplient.
Mais le Tatare a d'autres soucis en tête : depuis 1984, il se sait atteint de ce sida qui commence à faire des ravages dans les milieux artistiques et homosexuels. S'il n’a jamais évoqué ses préférences amoureuses, Noureev ne s'en ait jamais caché et a vécu sa sexualité toute libertine avec toujours la même soif de liberté, avant d'être rattrapé par la maladie. Il va alors lancer toutes ses forces dans ce combat, refusant d'arrêter de danser et de faire des projets.

Le voici en 1989, quelques mois après avoir revu sa mère à Oufa, qui foule de nouveau les planches du Kirov de Saint-Pétersbourg. Quelle revanche ! Mais le retour en France est plus difficile puisqu'il doit quitter son poste à l'Opéra pour cause d'absences répétitives et de caractère tyrannique. Il choisit alors de vivre pleinement sa passion pour la musique en devenant chef d'orchestre, mais la maladie est la plus forte et c'est dans un fauteuil que, le 8 octobre 1992, il reçoit sur la scène de l'Opéra Garnier la cravate de Commandeur des Arts et Métiers.
Il meurt 3 mois plus tard, le 6 janvier, 1993, jour de la Noël russe. Sa dernière folie sera l’hommage que viendra lui rendre le monde des Arts et de la Danse en bas des marches du grand escalier de l’Opéra, où a été déposé son cercueil bercé par le son de la 13e fugue de Bach, une fugue inachevée.
Traverser le monde en courantVoici un extrait du Second Faust de Johann Wolfgang von Goethe qui fut lu lors de la cérémonie d'hommage à Noureev à l'Opéra de Paris, le 12 janvier 1993 :
« Je n'ai fait que traverser le monde en courant ;
J'ai saisi aux cheveux chaque désir
Laissant aller ce qui ne me plaisait pas,
Laissant passer ce qui m'échappait.
Je n'ai fait que convoiter,
Accomplir mes desseins
Et convoiter encore ; ainsi, plein de vigueur,
J'ai passé ma vie dans l'impétuosité, d'abord grand et puissant ;
Mais aujourd'hui je vais avec sagesse et réflexion. [...]
Celui-là seul mérite la liberté et la vie
Qui doit chaque jour les conquérir.
Ainsi environnés de dangers,
L'enfant, l'homme, le vieillard passeront ici vaillamment leurs années.
Je voudrais voir une foule animée d'une telle activité,
Je voudrais être sur une terre libre avec un peuple libre ;
Je pourrais alors dire au Moment :
Demeure donc, tu es si beau !
La trace de mes jours terrestres ne peut être anéantie dans les Eons…
Dans le pressentiment d'une si grande félicité
Je jouis maintenant du plus sublime moment » (Johann Wolfgang von Goethe, Le Second Faust, 1832).Noureev au musée
Homme de culture et grand collectionneur, Noureev est à l'honneur dans un musée méconnu, le Centre national du costume de scène, à Moulins.
Voulu par le danseur qui demandait dans son testament la création d'« une galerie d'exposition commémorant [son] style de vie et [sa] carrière », ce lieu de mémoire a pu compter sur l'aide de la puissante Fondation Rudolf Noureev qui gère son héritage, et ainsi sauver de l'éparpillement près de 700 objets.
On peut y revivre son parcours à travers des documents personnels mais aussi retrouver l'atmosphère de son appartement du quai Voltaire où s'entassaient œuvres d'art et kilims. Le musée renferme également près de 200 000 costumes, accessoires et décors utilisés à la Comédie-Française ou à l'Opéra de Paris. Une visite pleine de couleurs et de dentelles !
Bibliographie
Ariane Dollfus, Noureev l'insoumis, éd. Flammarion, 2007,
Bertrand Meyer-Stabley, Noureev, éd. Payot, 2003,
Rudolf Noureev, Autobiographie, éd. Arthaud, 2016 (1962) ,
Claire Dodd, Le Monde du ballet, éd. Bordas, 1994.
-
Par Frawsy le 9 Juin 2017 à 15:14
Ne touchez pas à mes week-ends !
«Le vendredi soir, mes week-ends sont remplis de promesses. Ils se présentent comme une longue plage de possibles», écrit notre rédactrice en chef Johanne Lauzon. Mais entre le vendredi et le dimanche, la banalité prend trop souvent le dessus, constate-t-elle.
Johanne Lauzon de ChatelaineLe vendredi soir, mes week-ends sont remplis de promesses. Ils se présentent comme une longue plage de possibles. De soupers complices, de sorties nourrissantes… et de petites victoires de nature domestique (le robinet qui coule sera enfin réparé, les fleurs qui attendent d’être transplantées depuis mai seront en terre…).
Photo: iStock
Seulement, je me retrouve souvent déçue le dimanche soir. Et le fichu robinet de la cuisine qui coule toujours.
Entre le vendredi et le dimanche, la banalité a pris le dessus. L’épicerie, la lessive, le ménage, les corvées autour de la maison et les rides de taxi gratis à mes enfants. Et c’est sans compter les courriels-en-attente-d’une-réponse qui me font sortir du lit aux aurores le samedi.
Tout ce que je peux échafauder comme rêves, des plus fous aux plus accessibles, s’écroule comme un château de cartes. On ne parle pas ici d’un aller-retour à Londres, mais d’une promenade au Jardin botanique ou de la visite d’une expo. Je cherche à rendre ces deux jours de congé mémorables pour ma famille – bonjour la pression! Une confidence: je ne suis pas à la hauteur. Ou rarement.
C’est que mes fins de semaine ne m’appartiennent plus. Et je ne suis pas la seule, ai-je constaté à la lecture du bouquin de l’auteure et journaliste torontoise Katrina Onstad, The Weekend Effect (HarperCollins).
«Travailler plus qu’il y a une décennie est la norme pour la plupart des employés, et ces appareils conçus pour nous faire gagner du temps ne font que nous en arracher davantage. Le week-end est devenu une extension de la semaine de travail, ce qui par définition signifie qu’il n’est plus un week-end», écrit-elle.
Les frontières entre boulot et «temps libre» s’effritent. La déception nous attend donc au tournant du samedi soir: la maison est un tel bazar qu’on n’a pas invité les amis…
Bien sûr, nous manions encore la moppe et le plumeau plus souvent que nos chums. Mais ce n’est pas tant une question de partage des tâches que d’attentes démesurées qu’on a envers nous-mêmes. Nous cherchons à distiller du merveilleux dans nos week-ends, à nous rendre tout entières disponibles à nos rejetons. Nous voulons ainsi nous excuser de notre manque de présence, émotionnelle ou physique, tout au long de la semaine, juge Katrina Onstad.
Quand les parents ont l’impression de ne pas passer assez de temps avec leurs enfants, ils sont plus anxieux ou plus tendus, avance le sociologue Scott Schieman de l’Université de Toronto, qui s’intéresse à la conciliation travail-famille dans le cadre d’une étude échelonnée sur plusieurs années. «Il y a une certaine idée nostalgique autour des fins de semaine, qui devraient rester protégées», a-t-il dit à la journaliste.
Pourquoi toujours cette peur de ne pas en faire assez? L’entrée massive des femmes sur le marché du travail au cours des 40 dernières années aurait pu se traduire par une chute du nombre d’heures passées avec les enfants. Or, il n’en est rien, selon de récentes recherches menées à l’Université du Maryland. Les mères d’aujourd’hui sont aussi présentes que celles des années 1970, même si à l’époque seulement une fraction d’entre elles travaillaient à temps plein.
Alors, où trouvons-nous ces heures? Nous grignotons sur le temps de sommeil et de loisir. En d’autres mots, nous négligeons nos propres envies pour donner davantage de temps à nos filles et nos garçons. «Mais pourquoi au juste?» se demande Katrina Onstad, qui fait mention d’études ayant analysé l’agenda de mères. Le temps consacré à leurs enfants de 3 à 11 ans n’a pas eu d’effet sur les succès scolaires ou le bien-être psychologique de ces derniers. La qualité des interactions de la mère avec sa progéniture (chaleur, douceur, sensibilité…) serait d’ailleurs plus importante que le nombre de minutes investies.
Si la cadette a un entraînement de soccer, il n’est peut-être pas nécessaire de rester là à l’attendre. «Quand ils font leurs choses, faites donc les vôtres. Apportez un livre. Faites une promenade. Et répétez cette phrase: “Je te vois dans deux heures”», lance avec humour l’auteure.
La journaliste et maman d’une fille et d’un garçon termine son bouquin par un «manifeste pour un bon week-end». Elle nous invite à nous connecter aux autres – en personne, pas par l’entremise des réseaux sociaux –, à faire du bénévolat, à jouer, à explorer la nature, à partir à la recherche de la beauté et surtout… à en faire moins. Moins de magasinage, moins de ménage, moins de supervision d’enfants.
«Ne faites pas de plan, faites de la place», conclut-elle. Je compte bien mettre tout ça en pratique dès le week-end prochain. Promis, je ne ferai même pas de to do list. En attendant les grandes vacances, je vous souhaite de superbes fins de semaine! Pas trop remplies, de grâce. Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
La Tigresse au coeur tendre







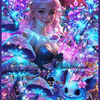













 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot

































