Propos recueillis par Christopher Gérard pour la revue Antaios, équinoxe de printemps 2001. Source : archaion.hautetfort.com — Agrégé de grammaire, Docteur ès Lettres, professeur de sanskrit et ancien doyen de la Faculté des Lettres et Civilisation de l’Université Jean-Moulin (Lyon), directeur d’études à l’Ecole pratique des Hautes Etudes, Jean Haudry est l’un des grands spécialistes du monde indo-européen. Il a fondé en 1981 l’Institut d’Etudes indo-européennes, récemment transformé en société savante indépendante à la suite d’une campagne de diabolisation. Il est l’auteur d’ouvrages fondamentaux sur le sujet comme L’Indo-Européen (Que sais-je ? 1798), Les Indo-Européens (Que sais-je ? 1965, retiré du catalogue), La religion cosmique des Indo-Européens (Archè/Belles Lettres), etc.
Qui êtes-vous ? Comment vous définir ?
Je me définis comme un linguiste spécialiste des langues indo-européennes anciennes qui est passé progressivement de l’étude des formes et des structures grammaticales et lexicales à celle du sens correspondant, et du sens aux réalités et aux situations, donc aux locuteurs de la langue reconstruite. C’est ainsi que je suis passé de la reconstruction de l’indo-européen à l’étude de la tradition indo-européenne.
D’où vous est venue cette passion pour les Indo-Européens ? Qui furent vos maîtres et que leur devez-vous ?
Cette passion des Indo-Européens m’est venue par une évolution naturelle qui s’observe chez plusieurs de mes prédécesseurs, et consiste en une quête du réel, du concret, du spécifique, démarche à contre-courant de nos jours où l’on privilégie le virtuel, l’abstrait et l’universel. Mes principaux maîtres dans l’enseignement supérieur ont été, par ordre chronologique, le latiniste Jacques Perret, les indianistes Louis Renou et Armand Minard, le linguiste généraliste André Martinet, l’indo-européaniste Emile Benveniste. Je leur dois non seulement ma formation dans les domaines correspondants, mais aussi un appui décisif dans les débuts de ma carrière : Renou et, après sa disparition, Minard ont dirigé ma thèse de doctorat d’état sur l’emploi des cas en védique ; j’ai été l’assistant à la Sorbonne de Perret et de Martinet, et l’approbation que Benveniste a donnée à mes premiers essais a sûrement pesé lourd.
Vous avez connu Georges Dumézil. Marcel Schneider, qui fut son ami, suggère que la fascination pour le Nord du grand historien des religions fut « le secret du Renan du XXème siècle ». Qu’en pensez-vous ? Quelle était l’attitude de Dumézil face au Sacré ? Peut-on parler comme Schneider « d’une sorte de panthéisme spiritualiste »?
Je n’ai connu personnellement Georges Dumézil qu’assez tard, et très peu. Etudiant, puis assistant, à Paris, je me suis consacré exclusivement – outre mon service – à l’apprentissage des langues indo-européennes anciennes et de la linguistique générale, avant de m’engager dans la préparation de ma thèse. Nommé chargé d’enseignement à Lyon en 1966, de nouvelles tâches s’y sont ajoutées, sans parler des péripéties inattendues de 1968 et années suivantes. C’est après plusieurs années de contre-révolution et d’administration que j’ai pu reprendre mes recherches, et en élargir l’horizon. J’ai lu ou relu Dumézil et éprouvé le regret de n’avoir pas suivi ses enseignements quand j’en avais la possibilité. Je ne l’ai rencontré que trois fois en privé, à l’occasion de soutenances de thèse qu’il m’avait demandé d’organiser à l’Université pour deux de ses anciens élèves, et pour lui présenter le premier jet de mon ouvrage sur les Indo-Européens destiné à la collection Que sais-je ? Cet entretien fut naturellement consacré à cet ouvrage et les précédents, si j’ai bonne mémoire, à organiser la soutenance, et à évoquer des souvenirs de sa propre thèse de doctorat. C’est dire que nous n’avons pas abordé aucun des points que soulève votre question. J’ai donc toujours ignoré ses convictions philosophiques, ainsi que ses opinions et appartenances politiques, avant qu’elles ne soient divulguées de la façon que l’on sait. Je n’ai pas l’impression qu’il ait éprouvé une fascination particulière pour le Nord, que ce soit au plan géographique ou anthropologique. Ses domaines d’élection étaient plutôt Rome, le monde indo-iranien, l’Arménie (et, hors du monde indo-européen, le Caucase) ; s’il y a adjoint le monde nord-germanique, c’est simplement parce que du point de vue de la religion les autres secteurs du monde germanique ancien, christianisés plus tôt, ne fournissent guère de données. Et s’il a rappelé dans un passage de Jupiter, Mars, Quirinus la « prédominance marquée du type nordique » chez les Indo-Européens, ce n’est pas de la fascination, mais l’énoncé d’une évidence. Plus généralement, l’étude des religions, surtout quand elle est comparative, ne constitue pas, en général, une expérience du sacré : Julius Evola disait fort justement que la science est une connaissance morte de choses mortes. Principe qui souffre quelques exceptions, dont la plus notable est Mircea Eliade. Mais je ne sais si c’était le cas pour Dumézil.
L’une des critiques qui revient de plus en plus souvent aujourd’hui chez divers chercheurs (Lincoln, Dubuisson, etc.) plus ou moins hostiles au principe même de la démarche dumézilienne, est que le mythologue aurait été trop soumis à une vision centripète et « platonicienne » des mythes. Qu’en pensez-vous ?
Parmi les sycophantes qui se sont attaqués à Dumézil, il y a eu un peu de tout. Des gens animés par la passion politique, de véritables procureurs staliniens des procès de Moscou. Il y a eu aussi des fruits secs, incapables de produire quoi que ce soit d’original, qui se retranchent derrière la méthodologie, rideau de fumée qui masque leurs insuffisances, et leur permet de s’en prendre à ceux qui ont produit, avant que de leur production se dégage une méthode. Il est vrai que les reconstructions duméziliennes sont le plus souvent synchroniques, voire achroniques, en tout cas non historiques. Mais c’est inévitable dans un premier temps, tout comme pour les reconstructions linguistiques. C’est seulement dans un deuxième temps, et sur la base de données nouvelles, que l’on peut espérer parvenir, dans les cas les plus favorables, à une chronologie relative, voire à une datation. Il n’y a là rien de « platonicien », et moins encore de maurrassien !
Comment définiriez-vous la notion de sanatana Dharma ?
Le dharma sanatana : l’adjectif sanatana est un dérivé en –tana- (indo-européen *-t(e)no-, suffixe probablement issu d’un dérivé de la racine *ten- « tendre », « s’étendre »), bâti comme les adjectifs latins cras-tinus sur cras « demain » , diu-tinus sur diu « longtemps », matu-tinus sur * matu- « le matin », et leurs homologues grecs et lituaniens sur une forme adverbiale (non attestée) *sana, « jadis » (ou sens similaire), tirée de l’adjectif sana- « ancien, vieux » (latin sen-ex, etc.). Il signifie « originel », « qui se prolonge depuis l’origine ». Qualification paradoxale pour dharma, forme récente (le Rigvéda ne connaît que dharman-, avec le sens de « fait de maintenir, de se maintenir, maintien, comportement », et désignant une réalité qui l’est aussi : le système des castes (jati-) des droits et des devoirs correspondants, bien qu’il soit censé se fonder sur la structure même de l’univers, s’est constitué progressivement en Inde. Une première attestation figure dans un texte appartenant aux parties récentes du Rigvéda, où le terme utilisé est varna- « couleur (symbolique )» Mais la codification des droits et des devoirs de chacune des trois castes aryennes (les « deux fois nés ») et de la quatrième caste, non aryenne, la répartition de la vie des brahmanes en quatre périodes ne se fixent que dans les dharmasatra et dharmashastra, dont le plus connu est le Manava- dharmashastra, les « lois de Manou ». Naturellement, si l’on traduit sanatana par « éternel », la conception d’un dharma sanatana relève de l’illusion commune aux diverses sociétés traditionnelles sans écriture de la permanence de leurs institutions. Mais si l’on adopte une traduction comme « immémorial », « traditionnel », la conception apparaît justifiée : le système des quatre castes de l’époque classique provient effectivement de celui des trois varna de l’époque védique, et de la période précédente (indo-iranienne) ; système qui, à son tour, reflète la structure indo-européenne des trois fonctions et des trois couleurs –initialement cosmiques – qui leur sont associées : le blanc du ciel du jour, le rouge des deux crépuscules, le noir de la nuit.
Vous avez préfacé la traduction française du livre de L. Kilian De l’ Origine des Indo-Européens (Labyrinthe, Paris 2000), où est défendue la thèse de l’origine paléolithique et nordique des IE. En quoi cette thèse vous semble-t-elle probable ?
Ce que Lothar Kilian nomme, après Herbert Kühn et d’autres, l’origine paléolithique des Indo-Européens est une conception d’archéologues fondée sur des continuités constatées ou supposées entre diverses cultures préhistoriques d’Europe, et sur la constatation qu’aucune des cultures néolithiques ne correspond à la zone d’expansion des Indo-Européens. Le linguiste ne peut pas les suivre, pour la simple raison que le vocabulaire reconstruit comporte un certain nombre de termes qui attestent de façon claire la pratique de l’agriculture et de l’élevage, et l’utilisation du cuivre, ce qui correspond au néolithique récent ou âge du cuivre. D’autre part, une part notable de la tradition correspond manifestement à une société de l’âge du bronze (donc postérieure à la période commune), la « société héroïque » de la protohistoire. Mais « ne pas suivre » ne signifie pas « rejeter », bien au contraire : l’hypothèse paléolithique s’intègre dans une conception évolutive de la reconstruction, linguistique et culturelle. Elle donne consistance à un petit nombre de données linguistiques bien établies, mais difficilement explicables dans une culture du néolithique final, comme la place qu’y tient le vocabulaire de la chasse. La reconstruction des cultures est une entreprise pluridisciplinaire ; chaque discipline y apporte ce qu’elle peut apporter. Il en va tout autrement de l’hypothèse « nordiste ». Ici, l’étude des traditions, confirmée par l’interprétation de certains termes, comme la notion, rare dans les langues du monde, de « ciel du jour », indo-européen *dyew-, et l’absence, tout aussi exceptionnelle, d’une désignation du « ciel », et surtout l’équivalence entre termes relatifs au jour de vingt quatre heures et termes relatifs à l’année (la notion d’ »aurore(s) de l’année ») conduisent à chercher l’origine de cette part de la tradition indo-européenne bien plus loin vers le nord que ne le font les archéologues, Kilian inclus. En attendant une possible convergence, ni les uns ni les autres n’ont intérêt à s’autocensurer.
Vous avez défendu l’hypothèse du type nordique comme type idéal, ce qui fait pousser des cris d’orfraie à certains que le concept même d’ethnie terrorise. Quels sont les principaux arguments à opposer aux tenants de plus en plus nombreux d’une vision centrifuge et dissolvante de cette recherche des origines ?
Qu’il y ait eu chez les Indo-Européens un « type idéal », celui de leurs héros et de leurs Dieux, est une évidence : tous les peuples en ont un, qui correspond naturellement au type dominant (par le statut, sinon par le nombre). Xénophane de Colophon en tirait un argument en faveur du relativisme en matière de religion : « les Ethiopiens se représentent leurs Dieux noirs et avec un nez épaté, les Thraces leur prêtent des yeux bleus et des cheveux roux. » Grâce au réalisme de l’art classique, et plus encore de l’art hellénistique, nous savons parfaitement comment les Grecs se représentaient leurs Dieux et leurs héros, en quels termes ils en faisaient le portrait ; et, plus tard, comment les physiognomonistes ont décrit le « Grec véritable », par opposition aux métèques, esclaves, etc. : il est à l’origine semblable aux barbares du nord. Comme chez eux, le type nordique domine dans la couche supérieure de la population. Tout cela est bien connu depuis plus d’un siècle ; la formule de Dumézil à laquelle je faisais allusion précédemment résume les conclusions auxquelles les chercheurs étaient parvenus à l’époque. Ce n’est pas l’étude des momies du bassin du Tarim (Xin-jiang), parmi lesquelles le type nordique est bien représenté, qui risque de les infirmer. Mais à quoi bon opposer des arguments aux négateurs d’évidence ? A ceux qui refusent d’admettre ce qui ne va pas dans le sens de leur argumentaire, et surtout de leurs objectifs, avoués ou inavoués ? Comme l’un des objectifs majeurs de l’idéologie dominante est le métissage des peuples d’Europe à partir de populations africaines et asiatiques, l’évidence leur est inacceptable. A leurs yeux, plus on apporte de preuves et de témoignages, plus on aggrave son cas, ainsi qu’il arrive en d’autres occasions.
Peut-on dire que le fondement de la « Tradition » indo-européenne consisterait en une religion de la vérité ?
Ce que j’ai nommé, à tort ou à raison, « religion de la vérité », en donnant à religion sa valeur originelle de « scrupule qui inhibe, qui retient », ne représente pas, tant s’en faut, l’ensemble de la tradition indo-européenne, et ne tient qu’une part modeste dans la religion proprement dite, même si, dans le monde indo-iranien, le vocabulaire du culte (les nombreux dérivés de la racine *yaž- « ne pas offenser ») est fondé sur le « culte négatif » ; bien moins, par exemple, que les trois fonctions duméziliennes. Elle correspond à un ensemble de règles de comportement (respect des engagements contractuels, de la justice distributive, etc.), qui ne valent initialement que pour les chefs dans leurs rapports avec d’autres chefs de la même ethnie. L’hymne avestique à Mithra (yašt 10) en fournit une bonne illustration. Elle ne s’étend aux rapports internes du groupe que dans la « société héroïque » de la période finale de la communauté indo-européenne, et surtout dans les périodes suivantes ; périodes où les rapports contractuels qui lient le seigneur et ses hommes, qu’il a recrutés hors de son lignage et parfois même de sa tribu, l’emportent sur les liens naturels, ceux du lignage. Une telle société est par nature instable : aucune communauté ne peut reposer durablement sur des base contractuelles, en dépit du mythe rousseauiste du « contrat social ». Bien vite, les liens lignagers reprennent leur importance. Par exemple, au Moyen Age, on voit des jeunes compagnons quitter le compagnonnage seigneurial pour s’établir, se marier, et recevoir de leur seigneur un fief viager qui peut devenir à son tour un bien héréditaire. Au plan religieux, le « culte négatif », consistant à « ne pas offenser » la divinité, « ne pas violer » (ses engagements, etc.) s’accompagne toujours d’un « culte positif » consistant en sacrifices, rites, prières, etc.







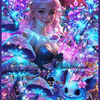














 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot











