-
Droite et gauche : deux siècles d'affrontement
Après le hold-up sur les référendums français et néerlandais de 2005, après le renoncement des Grecs face au Diktat de Berlin en 2015, on pouvait croire que c'en était fini de la démocratie sur sa terre natale.
Mais une nouvelle fois, les Anglais l'ont ranimée en votant le Brexit contre l'avis des « gens éduqués » (*). L'onde de choc a traversé l'Atlantique avec, aux États-Unis, l'éviction de la favorite Hillary Clinton aux présidentielles du 8 novembre 2016. Elle a enfin traversé la Manche avec, en France, la victoire d'une droite assumée en la personne de François Fillon.
Quelles que soient nos opinions politiques, réjouissons-nous de ce retour en force du suffrage universel, décidément plus fort que les médias, les sondages et les puissances d'argent. Il ne reste plus à la gauche qu'à se redéfinir afin de revenir à des débats politiques clairs et tranchés comme les aiment les citoyens...
L'affrontement entre la « droite » et la « gauche » est l'essence de la démocratie moderne. En France, chaque fois qu'il s'est exprimé avec clarté à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des députés, il a conduit à des réformes efficaces et durables, que ce soit sous la Révolution (1789-1799), exception faite de la brève période de la Terreur (1793-1794), au début de la IIIe République ou sous la IVe République, avant l'affaire algérienne.
Il apparaît en France, très précisément le 11 septembre 1789. Ce jour-là, les députés de l'Assemblée constituante, réunis pour délibérer sur le droit de veto accordé au roi Louis XVI, se répartissent spontanément de part et d'autre du président : à droite, aux places d'honneur, les « monarchiens » désireux d'accorder au roi un droit de veto absolu ; à gauche, les opposants qui veulent limiter dans la durée son droit de s'opposer aux lois.
De cette répartition des députés par affinités datent les clivages entre une droite (réputée réactionnaire ou conservatrice) et une gauche (réputée révolutionnaire ou réformiste) qui rythment aujourd'hui encore la vie politique dans toutes les démocraties.
Dès les débuts de la Révolution, donc, on voit se dessiner le fil conducteur de cet affrontement entre des hommes désireux les uns comme les autres d'assurer le bien-être de leurs concitoyens et la prospérité du pays : d'un côté ceux qui souhaitent améliorer les institutions existantes en s'appuyant sur la tradition, la religion et les lois coutumières ; de l'autre ceux qui appellent à faire table rase du passé et construire un monde nouveau. Ces derniers, qui représentent la gauche, ont pour guide spirituel sous la Révolution Jean-Jacques Rousseau, mort peu avant, en 1778. Robespierre en est un fervent disciple.
Après l'échec de sa fuite à Varennes (21 juin 1791), le roi forme un gouvernement de droite avec des ministres issus du club des Feuillants, partisans d'une monarchie constitutionnelle (comme Lafayette, Barnave, Le Chapelier, La Rochefoucauld-Liancourt...). Mais le 23 mars 1792, il remplace ces modérés par des députés de gauche issus du groupe des Girondins, parce que ces derniers souhaitent comme lui, mais pour des raisons opposées, engager la guerre contre les puissances européennes.
Au sein de la gauche, les Girondins s'opposent à la Montagne et à leur chef Robespierre, qui refuse la guerre et se montre même hostile à la peine de mort. Mais quand le pays sera envahi et la Révolution menacée, Robespierre n'hésitera pas à promulguer la Terreur et la levée en masse.
Une lente gestation
Les clivages politiques réapparaissent timidement à la chute de Napoléon 1er, tempérés par un suffrage censitaire qui réserve le droit de vote aux contribuables aisés, une centaine de milliers en tout et pour tout. À la Chambre des députés s'opposent trois tendances, toutes droitières : les ultraroyalistes ou « ultras », les « constitutionnels », proches du roi Louis XVIII, et les « indépendants », plutôt libéraux.
Sous le règne du « roi-bourgeois » Louis-Philippe 1er, on voit apparaître aussi des courants bonapartistes et républicains. Tous ces courants vont s'épanouir avec la révolution de février 1848 qui chasse le roi et instaure la IIe République. Mais l'introduction du suffrage universel change la donne : réfractaires aux idées républicaines et sensibles aux discours de leurs notables, les paysans envoient une écrasante majorité de monarchistes à l'assemblée.
Aux élections législatives du 13 mai 1849, on retrouve pour de bon une opposition droite-gauche :
- d'un côté le « Parti de l'Ordre » (450 sièges sur 715), qui réunit tous les conservateurs (royalistes légitimistes et royalistes orléanistes, bonapartistes...) autour d'un slogan : Ordre, Propriété, Religion,
- de l'autre, la gauche républicaine qui a emprunté aux révolutionnaires d'antan le nom de « Montagne », de quoi effrayer les modérés !Les excès et les maladresses des uns et des autres conduisent au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte.
En ce milieu du XIXe siècle émerge la question sociale, de pair avec la révolution industrielle et la multiplication de grandes usines. L'historien et député Alexis de Tocqueville l'a entrevue et s'en émeut dans un discours à la Chambre le 27 janvier 1848 : « Regardez ce qui se passe au sein de ces classes ouvrières, qui, aujourd'hui, je le reconnais, sont tranquilles ; (...) mais ne voyez-vous pas que leurs passions, de politiques, sont devenues sociales ? »
La même année, Karl Marx publie un vibrant pamphlet révolutionnaire : le Manifeste du Parti communiste. Le philosophe allemand va devenir dès la IIe République une nouvelle référence idéologique de la gauche et des députés se réclamant du socialisme.
Momentanément éteint avec l'instauration du Second Empire, le débat politique renaît de ses cendres à la faveur de la libéralisation du régime avant de s'épanouir sous la IIIe République. Les monarchistes de tous bords quittent peu à peu la scène. La Chambre, toute entière républicaine, se divise désormais entre conservateurs, socialistes et radicaux, avec d'infinies nuances.
Des valeurs très flexibles
En France comme dans les autres démocraties européennes, le clivage droite-gauche prend tout son sens dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais comme on l'a vu dès la Révolution, ce clivage se double de divergences profondes à l'intérieur de chaque camp. D'autre part, d'une génération à la suivante, au gré des circonstances, droite et gauche évoluent d'une position à son contraire. Bien malin qui pourrait donner une définition intangible des « valeurs » de l'une et de l'autre.
La droite, on l'a vu, est née de la fidélité à la tradition et au souverain. À l'image du roi, elle affiche une bienveillance paternelle ou paternaliste à l'égard des classes populaires. Sous le règne de Louis-Philippe, le Président du Conseil Casimir Perier déclare à la Chambre des députés : « Il faut que les ouvriers sachent qu'il n'y a de remède pour eux que la patience et la résignation ».
Attachés, cela va de soi, aux valeurs chrétiennes, les conservateurs se montrent pionniers en matière d'éducation. C'est au protestant François Guizot que l'on doit en 1833, toujours sous le règne de Louis-Philippe, la création d'un enseignement primaire public. Le même personnage participe à la première campagne en faveur de l'abolition de la peine de mort, avec le jeune Victor Hugo qui est à l'époque un fervent monarchiste. Le débat ne sera relancé que beaucoup plus tard, dans les années 1970, pour aboutir en 1981.
Notons que la monarchie s'honore d'avoir toujours répugné à faire tirer sur le peuple. Louis XVI a désarmé ses gardes suisses lors de l'assaut des Tuileries le 10 août 1792, quitte à ce qu'ils soient massacrés par la populace. Louis-Philippe a dû plusieurs fois réprimer des soulèvements mais il a préféré abdiquer plutôt que de faire tirer sur les manifestants les 22-24 février 1848. Les gouvernants républicains, forts de leur légitimité électorale et de leurs certitudes, n'ont pas eu les mêmes scrupules dans le massacre des ouvriers rebelles en juin 1848 et le massacre des communards en mai 1871. À chaque fois des milliers de morts.
La droite est par nature décentralisatrice et fait confiance aux collectivités locales pour gérer les conflits d'intérêts. C'est l'héritage de l'Ancien Régime : le roi, y compris même Louis XIV, devait composer avec des corps intermédiaires et des contre-pouvoirs légitimés par leur ancienneté (Parlements, Église...) ; il avait somme toute moins de pouvoirs que le président François Hollande, lequel peut tout se permettre du fait d'une majorité parlementaire tétanisée par la crainte d'une dissolution.
Conservatrice, la droite attire à elle les possédants qui ne tiennent pas à perdre leur bien dans une quelconque aventure, qu'il s'agisse des paysans propriétaires ou des milieux d'affaires. Ces milieux d'affaires sont pour la même raison naturellement pacifistes. En 1871, leur porte-parole Adolphe Thiers s'accommode du traité de Francfort qui clôt la guerre franco-prussienne. En 1911-1914, Joseph Caillaux tente en vain d'arrêter la marche à la guerre et s'oppose au revanchard Raymond Poincaré.
La droite, c'est aussi l'aristocratie, attachée aux valeurs militaires et à la nation dont le souverain était autrefois le représentant. Légitimiste, elle n'est pas portée comme les révolutionnaires de 1792 à des guerres de conquêtes qui violeraient les droits des autres souverains. Mais elle place au-dessus de tout l'indépendance nationale.
Cet héritage se ressent en 1940, quand le pays est envahi et soumis à l'occupation étrangère : des rejetons de l'ancienne aristocratie, militaires, croyants et modérément républicains, sont parmi les premiers - sinon les premiers - à s'engager dans la Résistance. Citons Charles de Gaulle bien sûr, Philippe Leclerc de Hauteclocque, Honoré d'Estienne d'Orves. L'indépendance nationale sera aussi le fil conducteur de la politique de De Gaulle à son retour au pouvoir en 1958 : allègement du fardeau colonial, émancipation de la tutelle américaine, dissuasion nucléaire... Philippe Séguin revendiquera son héritage en dénonçant les abandons de souveraineté nés du traité de Maastricht et de la monnaie unique.
Par pacifisme et désir de ne pas ajouter la guerre à la guerre, le malheur au malheur, des socialistes, anciens socialistes ou communistes ont par contre rejoint dans la Collaboration le maréchal Pétain, un militaire républicain et laïc issu de la paysannerie. Citons Pierre Laval bien sûr, le philosophe Alain, l'écrivain Paul Claudel, Marcel Déat, agrégé de philosophie et ancien député socialiste, les communistes René Belin, Ludovic-Oscar Frossard, René Doriot... Il s'en trouve aussi comme Jean Moulin qui ont rejoint la Résistance, en nombre croissant à mesure de l'avancement de la guerre.
La gauche, dès la Révolution, a été pénétrée de la foi en un progrès indéfini de l'humanité. Elle tire de Rousseau la conviction que l'on réparera les injustices passées en conférant au Peuple les attributs du Souverain, autrement dit en instaurant une démocratie pleine et entière.
Elle est aussi universaliste et convaincue d'une égalité absolue entre tous les hommes dans le droit fil de l'enseignement chrétien (« Il n'y a ni hommes ni femmes, ni Juifs ni Grecs, ni hommes libres ni esclaves », saint Paul, épître aux Galates). Cette double approche universaliste et patriote transparaît dans la Déclaration des Droits de l'Homme [l'humanité] et du Citoyen [le Peuple]. En foi de quoi les révolutionnaires accordent volontiers la citoyenneté aux éminents citoyens qui partagent leurs valeurs, Anacharsis Cloots ou Thomas Paine.
Elle dénie aussi aux souverains toute forme de légitimité et s'autorise à libérer les autres peuples de leur oppression. Le 19 novembre 1792, l'assemblée révolutionnaire vote un décret qui énonce : « La Convention nationale déclare au nom de la nation française qu'elle accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront reconquérir leur liberté ».
Sous la IIIe République, toujours au nom de l'universalisme et du progrès, la gauche républicaine s'engage activement dans la colonisation de l'Afrique en vue de « civiliser les races inférieures », selon le mot célèbre de Jules Ferry (1885). Il n'est pas question pour autant de fondre la nation (*) dans une communauté universelle : on crée un statut de l'indigénat subordonné aux citoyens français. C'est un changement radical par rapport à la période romantique, quand les peintres et les poètes s'énamouraient de l'Orient sans nuance de mépris ni envie de « civiliser » leurs habitants.
À l'exception notable de Georges Clemenceau, la gauche va rester fidèle à sa politique coloniale jusqu'à la fin des années 1950 et la chute du gouvernement Guy Mollet, qui a engagé l'expédition de Suez et donné les pleins pouvoirs au général Massu pour pacifier Alger.
Représentée par des bourgeois pétris de culture classique, la gauche révolutionnaire rêve d'une société de petits propriétaires, paysans et artisans, et va la réaliser grâce à la vente des biens nationaux enlevés au clergé. Elle ne se soucie pas des ouvriers, lesquels sont encore ultra-minoritaires, et va réprimer sans état d'âme la « Conjuration des Égaux » de Gracchus Babeuf, des communistes avant la lettre.
Tout change, on l'a vu, au milieu du XIXe siècle, avec la multiplication des sites industriels et l'émergence d'une classe ouvrière opprimée et revendicative. Elle trouve une oreille attentive chez des bourgeois éclairés comme les Allemands Karl Marx et Ferdinand Lassalle. En France, c'est paradoxalement sous le Second Empire qu'elle est écoutée : Napoléon III lui accorde le droit de grève tandis que les écrivains et les peintres se penchent avec compassion sur son sort : Les Misérables (1862).
Avec l'écrasement de la Commune, la IIIe République évacue le problème. Le jeune et fougueux Léon Gambetta déclare au Havre, en 1872 : « Il n'y a pas de question sociale. La réforme politique contient en germe les réformes sociales ». Il précise sa pensée un peu plus tard à Grenoble en appelant la petite bourgeoisie et les paysans propriétaires à soutenir la République, sans souci des prolétaires.
Il faudra attendre le règlement du conflit entre la République et l'Église pour que la gauche se saisisse des enjeux sociaux. En 1910, Léon Bourgeois instaure les Retraites Ouvrières et Paysannes, première grande réforme sociale. En 1936, le Front populaire tentera à marches forcées de rattraper le retard en matière de législation sociale. Après la Libération, la montée en puissance du Parti communiste et des organisations ouvrières, de pair avec l'expansion industrielle du pays, vont placer la classe ouvrière au cœur de la gauche.
La population ouvrière, à l'égal de l'ensemble des classes populaires, se montre en général bienveillant à l'égard des travailleurs immigrés que le patronat a fait venir des pays limitrophes et de Pologne à partir du milieu du XIXe siècle. Les dirigeants de la gauche ne tardent pas toutefois à s'en inquiéter. Jules Guesde, député marxiste et révolutionnaire, écrit le 10 février 1886 : « Ils sont 800 000 ouvriers étrangers qui, travaillant à tout prix, font outrageusement baisser les salaires, quand ils ne les suppriment pas complètement pour nos ouvriers expulsés des usines ».
Cette dénonciation du dumping social se retrouve dans la bouche des dirigeants communistes jusque dans les années 1970. Elle s'exprime aussi de façon plus civile chez Michel Rocard, Premier ministre de François Mitterrand. Il déclare le 18 novembre 1989, devant la Cimade, association d'aide aux migrants : « N'y a-t-il pas aujourd'hui un certain détournement du droit d'asile qui, s'il n'y est pas porté remède, finira par menacer l'existence de ce droit lui-même ? (...) Il s'agit d'accueillir les personnes persécutées pour leur opinion et leurs engagements, notamment politiques, et elles seulement ». Le 3 décembre 1989, il précise sur TF1 : « Nous ne pouvons pas héberger en France toute la misère du monde... La France doit rester une terre d'asile mais pas plus ».
Et maintenant ?
Les points de vue ci-dessus ne manqueront pas de surprendre le lecteur de 2016 parce qu'ils reflètent une droite et une gauche éloignées de celles que nous connaissons. Depuis les années 1970, en effet, les clivages se sont brouillés. On a assisté à un superbe tête-à-queue tel qu'aujourd'hui la gauche et la droite adorent ce qu'elles ont autrefois abhorré et vice-versa.
On peut en voir l'origine dans les transformations des années 1970 arrivée du microprocesseur avec ses incidences sur la robotisation, l'informatique et à plus long terme internet ; chute de la fécondité dans les pays industrialisés ; crise environnementale et remise en question de la croissance à tout va ; chocs pétroliers, fin des « Trente Glorieuses » et explosion du chômage ; crise du communisme européen.

Ces facteurs font que chancellent la base électorale de la gauche : les ouvriers pointent au chômage et la bourgeoisie libérale ne croit plus au progrès indéfini des techniques et de l'industrie. Le Parti communiste se racornit après son succès d'estime aux présidentielles de 1969 cependant que le Parti socialiste est refondé par François Mitterrand au congrès d'Épinay-sur-Seine de 1971 après le fiasco de son candidat Gaston Deferre aux mêmes présidentielles.
À droite, Valéry Giscard d'Estaing emporte la présidence de la République à la hussarde en 1974. Le jeune président (48 ans) et son Premier ministre Jacques Chirac (42 ans) pressentent le changement d'ère politique.
Ils s'engagent résolument dans des réformes sociétales hardies (avortement, divorce, droit de vote...) avec l'espoir qu'elles rallieront les nouveaux citoyens à leur camp. Peine perdue. La droite traditionnelle se rebelle. Jacques Chirac est renvoyé. Retour aux fondamentaux de la droite.

C'est finalement François Mitterrand et la gauche qui emportent la mise en 1981. Mais c'est au prix d'un changement total de paradigme que laisse pressentir la simple comparaison des deux affiches de campagne du candidat Mitterrand en 1965 (ci-dessus) et en 1981 (ci-contre) : sur la première, un paysage industriel polluant à souhait ; sur la seconde, un paysage bucolique.
Dans un premier temps, le président socialiste enchaîne les réformes à la volée dans un esprit très progressiste. Puis, en 1983, sous l'effet de la contrainte extérieure (déficits), il s'engage dans une politique néolibérale plus conforme à l'esprit du temps, symbolisé par Margaret Thatcher.
Sous l'empire de la nécessité, le Parti socialiste recompose sa base électorale en s'adjoignant la bourgeoisie libérale, représentée par des patrons ouverts sur la mondialisation et de jeunes énarques ambitieux, les diplômés menacés par le chômage, les fonctionnaires, enfin les « minorités visibles » ostracisées par le Front national. C'est un cocktail qui a fonctionné pendant trois décennies.
Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Les classes populaires se sont détournées d'une gauche devenue, tout autant que la droite libérale, le cheval de Troie de la mondialisation financière Et les « minorités visibles » attachées à des valeurs traditionnelles tiennent rigueur à la gauche de ses réformes de moeurs à destination de la bourgeoisie : mariage pour tous, droit au blasphème etc. Comme les classes populaires, elles s'inquiètent qui plus est d'une amplification brutale de l'immigration qui menace leurs efforts d'intégration.
Au moment où la droite traditionnelle se réaffirme sans complexe sous l'égide de son nouveau champion, gageons qu'à gauche, les électeurs auront soin de faire émerger un leader tout aussi décomplexé. Plutôt un protectionniste anti-libéral façon Arnaud Montebourg ou Jean-Luc Mélenchon qu'un social-libéral façon Manuel Valls ou Emmanuel Macron.
Joseph Savès votre commentaire
votre commentaire
-
6 décembre 1491
Charles VIII épouse Anne de Bretagne
À l'aube du 6 décembre 1491, dans le château de Langeais, près de Tours, Charles VIII l'Affable épouse la duchesse Anne de Bretagne. Elle a 14 ans et le roi de France 21.
C'est le début de la fin pour la Bretagne indépendante...
Marie Desclaux
Tumultueuses fiançailles
Le 19 août 1488, par le traité du Verger, le duc François II a dû promettre au roi de France que sa fille et héritière Anne ne se marierait pas sans son consentement. Et voilà qu'il meurt trois semaines après la signature du traité, le 4 septembre 1488, à 53 ans.

Née à Nantes le 25 janvier 1477, la petite duchesse a onze ans seulement quand elle succède à son père à la tête du duché.
Bien qu'affectée d'un boîtement de la jambe droite, elle devient l'objet des convoitises des princes les plus puissants d'Europe car de son futur mariage dépend le sort de la Bretagne.
Les seigneurs bretons, soucieux de leur indépendance, craignent plus que tout le roi de France, trop proche. En 1490, ils prient Anne d'épouser par procuration le futur empereur d'Allemagne Maximilien 1er de Habsbourg (31 ans).
Faute de pouvoir se rendre à Rennes, Maximilien délègue l'un de ses compagnons, le maréchal Wolfang von Polheim. Selon la coutume, celui-ci glisse sa jambe nue dans le lit de la fillette pour valider l'union par procuration.
Le roi de France Charles VIII n'ayant pas été consulté, il s'agit d'une violation caractérisée du traité du Verger, d'autant plus inacceptable pour la France qu'elle menace celle-ci d'un encerclement par les domaines des Habsbourg.
Ruptures de contratLe roi Charles VIII, piqué au vif, marche sur le duché à la tête de ses troupes. Après la prise de Nantes et le siège de Rennes, Anne comprend qu'elle ne peut pas compter sur le soutien de son lointain mari, d'autant que celui-ci est occupé à combattre les Turcs.
La jeune duchesse se résigne donc à épouser Charles VIII. Le roi de France, qui avait été fiancé 7 ans plus tôt à une fillette de 3 ans, n'a pas de scrupule à renvoyer sa promise, Marguerite d'Autriche, chez son père qui n'est autre que Maximilien !
Mariage en catimini
Comme le roi ne veut pas heurter inutilement la susceptibilité du fiancé éconduit ni risquer un enlèvement d'Anne, c'est en catimini que les futurs époux se retrouvent à Langeais, non loin de la frontière entre le royaume et le duché.
Le château appartient à la famille de Dunois, un ancien compagnon de Jeanne d'Arc. Dans la nuit, les compagnons du roi vont quérir un notaire dans la ville voisine et les deux conjoints se font une mutuelle donation sur le duché, en présence d'une assistance triée sur le volet, incluant le diplomate Jean d'Amboise et bien sûr Anne de Beaujeu, soeur aînée du roi et régente du royaume.

Il reste encore une petite formalité : l'annulation du mariage d'Anne et Maximilien ! Le pape se résigne à la signer (et à l'antidater) trois mois après la cérémonie de Langeais.
Ainsi la Bretagne rentre-t-elle dans le giron capétien. Elle deviendra formellement française à la génération suivante, en 1532, quand les états généraux de Vannes approuveront le rattachement du duché au royaume de France tout en préservant leurs privilèges ainsi que l'autonomie judiciaire et fiscale du duché.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Père Noël : faut-il faire croire aux enfants qu'il existe ?
Nathalie Mayer, Futura-Sciences
Lorsqu’on évoque le mythe du Père Noël, les avis – tant ceux des spécialistes de l’enfance que ceux des parents – divergent. Alors, devons-nous faire croire aux enfants que le Père Noël existe ? Petit pêle-mêle des différents points de vue…
Non, le Père Noël n'existe pas ! Faire croire le contraire à nos enfants, pas de doute, c'est un mensonge. Un mensonge honteux pour certains, notamment pour les parents qui gardent un souvenir douloureux de la révélation. Ceux-ci, parfois, refusent de perpétuer le mythe.
Toutefois, pour la plupart des gens, le Père Noël fait figure de bien joli mensonge. Un mensonge teinté de magie et de mystère. D'ailleurs, de l'avis de pédopsychiatres, le Père Noël fait partie de ces rites qui aident les enfants à grandir. Au sortir de l'enfance, arrêter de croire au Père Noël ne serait alors ni plus ni moins que faire l'expérience de la réalité.
Le Père Noël, ce gros mensonge
Pourtant, selon une étude menée par des psychologues de l'université d’Exeter(Royaume-Uni), mentir à nos enfants au sujet du Père Noël pourrait sérieusement entamer la confiance que nos petites têtes blondes nous accordent naturellement. Encore plus si ce mensonge est motivé par notre désir de revivre notre propre enfance plutôt que par celui de plonger nos petits dans un univers merveilleux, transformant ce mignon petit mensonge en « exercice moralement ambigu ».
L'étude pose également la question de l'insécurité qui peut naître dans les jeunes esprits à l'idée de ce personnage tout puissant amené à décerner chaque année les bons et les mauvais points. Les psychologues concluent qu'il n'est pas conseillé d'utiliser le Père Noël comme un « outil de contrôle » sur nos enfants.

Croire au Père Noël : jusqu’à quel âge ?
Généralement, c'est entre 6 et 10 ans que les enfants cessent de croire au Père Noël, l'âge auquel ils quittent doucement leur imaginaire d'enfant pour entrer dans un monde plus réel. Cependant, certains peuvent avoir envie de prolonger la magie un peu plus longtemps. Il peut alors être opportun de se demander pourquoi, car continuer de croire au Père Noël au-delà de cet âge peut être révélateur d'un enfant qui cherche à nier la réalité. Peut-être est-il alors souhaitable de l'amener à réfléchir à la question... avant que ses camarades de classe ne s'en chargent à votre place et de manière sans doute plus brutale.
Ceci étant posé, et si l'on se penche de plus près sur les lettres envoyées chaque année au vieux monsieur à la barbe blanche, il semblerait bien que les adultes qui continuent de « croire » en lui ne sont pas si rares que ça...
Comment dire que le Père Noël n’existe pas ?
Voici enfin un point sur lequel tout le monde semble à peu près s'accorder : lorsqu'un enfant commence à douter de l'existence du Père Noël, le mieux est de l'accompagner dans son cheminement vers la vérité. Certains spécialistes de l'enfance conseillent de souligner que la générosité et l'amour qu'il incarne, eux, sont bien réels. De quoi permettre aux enfants de mieux accepter la disparition, tout de même soudaine, du bienveillant vieillard.
Force est de constater que, finalement, la plupart des enfants acceptent bien la découverte de la non-existence du Père Noël. D'autant qu'une fois la vérité connue, l'enfant pourra se sentir comme mis dans la confidence. Il sera alors « un grand » !
 votre commentaire
votre commentaire
-
5 décembre 1360
Naissance du franc
Le 5 décembre 1360, à Compiègne, le roi Jean II crée une nouvelle monnaie, le «franc», de même valeur que la monnaie existante, la livre tournois.
La fille du roi mariée contre rançon
Jean II le Bon (c'est-à-dire le Brave) a été fait prisonnier à la bataille de Poitiers. Il a subi une longue captivité en Angleterre et son geôlier, le roi anglais Édouard III, lui a réclamé une énorme rançon, environ trois millions de livres tournois, soit 12,5 tonnes d'or.
Le royaume est ruiné et pour obtenir une partie de la rançon, Jean accepte une mésalliance avec le riche duc de Milan, Galéas Visconti. À ce marchand de médiocre extraction, il «vend» sa fille Isabelle contre 600.000 livres.
Édouard III accepte de libérer son prisonnier après un premier versement de 400.000 livres. Mais le roi de France doit s'engager à verser le reste et pour cela n'hésite pas à endetter son pays. C'est ainsi que, sur le chemin du retour, à Compiègne, il prend trois ordonnances. Il crée en premier lieu de nouvelles taxes et généralise l'impôt sur le sel, la gabelle. Le sel est un complément alimentaire vital et, qui plus est, en l'absence de réfrigérateur, il est, au Moyen Âge, indispensable à la conservation des viandes (les salaisons). La gabelle va devenir de ce fait incontournable et très impopulaire.
Le franc, rival du florinPour faciliter le règlement de sa rançon, le roi crée en second lieu le «franc». La nouvelle pièce commémore sa libération comme l'indique son appellation (franc et affranchissement sont synonymes de libre et libération). «Nous avons été délivré à plein de prison et sommes franc et délivré à toujours», rappelle le roi dans son ordonnance. «Nous avons ordonné et ordonnons que le Denier d'Or fin que nous faisons faire à présent et entendons à faire continuer sera appelé Franc d'Or».
Le premier franc
Le franc de 1360 est en or fin de 3,88 grammes. Il vient en complément de l'écu d'or qu'a introduit Saint Louis au siècle précédent, et de la livre tournois en argent. Il vaut une livre ou vingt sous tournois.Le premier franc représente le roi à cheval avec la légende «Johannes Dei GratiaFrancorum Rex». Une version ultérieure du franc, en 1365, représentera le roi à pied (le «franc à pied»).
Jean II le Bon et son fils, le futur Charles V suivent en matière monétaire les recommandations de leur conseiller Nicolas Oresme. Dans son Traité des Monnaies (1370), ce clerc, philosophe et traducteur d'Aristote, prône une monnaie stable, garante de la puissance du souverain, capable de rivaliser sur les marchés avec le prestigieux florin de Florence, qui domine l'Europe depuis déjà un siècle.
Rappelons qu'au Moyen Âge, les pièces de monnaie tirent leur valeur de leur poids en métal précieux (or ou argent). Les pièces de différents pays peuvent circuler côte à côte sur les marchés, leur attrait dépendant de la confiance que le public accorde à l'émetteur. Si celui-ci est suspect de tricher sur la quantité de métal précieux ou de laisser faire les faux-monnayeurs, sa monnaie tendra à être rejetée par le public et dévalorisée à son détriment.
Une rançon pour rienTandis que les Français s'échinent à payer au roi anglais la rançon pour la libération de son souverain, celui-ci revient en Angleterre comme prisonnier volontaire pour laver l'honneur d'un otage français qui s'était enfui sous prétexte d'un pèlerinage, son propre fils, Louis d'Anjou, pressé de rejoindre sa jeune épouse.
«Vous avez blêmi l'honneur de votre lignage», lance le roi à son trop malin rejeton. C'est en prison que meurt Jean II le Bon, le 8 avril 1364... De mauvaises langues susurrent que c'est moins l'honneur que le souvenir d'une belle Anglaise qui l'a ramené dans sa confortable prison.
La France, du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle, se montre attachée au bimétallisme : pièces principales en or et subdivisions en argent.
Le franc poursuit une carrière à éclipses. La pièce de Jean II le Bon et de Charles V est frappée jusqu'en 1385. Une pièce du même nom mais en argent reparaît brièvement en 1576 sous le règne du roi Henri III. À partir de Louis XIII, le franc n'est plus qu'une unité de compte. Il disparaît au profit de la livre, elle-même divisée en 20 sous ou 240 deniers. Mais dans le langage courant, on continue de parler de franc plutôt que de livre.

Au XVIIIe siècle, on tente à deux reprises d'introduire des billets en sus des pièces, les billets étant gagés sur des richesses réelles ou à venir.
Ce sont les ressources de la colonie de Louisiane dans le premier cas (expérience de John Law, sous la Régence, en 1716-1720) et les biens enlevés au clergé et aux émigrés dans le second cas (création des assignats par l'Assemblée Nationale, au début de la Révolution, en décembre 1789).
Dans l'un et l'autre cas, les pouvoirs publics ne résistent pas à la tentation d'imprimer plus de billets qu'ils n'ont de richesses en gage.

Ces billets sans contrepartie sont très vite rejetés par le public et l'on en revient à chaque fois aux pièces d'or ou d'argent.
Les pièces en franc sont remises à l'honneur par la Convention, sous la Révolution.
Une loi du 7 avril 1795, confirmée le 15 août 1795, fait du franc l'unité monétaire de la France, en remplacement de la livre. La nouvelle unité monétaire, très simple d'emploi avec ses décimes, ses centimes et ses millimes, est immédiatement adoptée.
Le Premier Consul Napoléon Bonaparte lui donne une base stable par la loi du 7 Germinal an XI (27 mars 1803) qui définit la nouvelle pièce de 1 Franc par «5 grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin». Une pièce en or de 20 francs est également créée sous le nom de Napoléon.
Bonaparte institue une Banque de France pour soutenir la nouvelle monnaie et développer la monnaie scripturale.
Le «franc germinal» va traverser avec succès le XIXe siècle, ses changements de régime et même la défaite de 1870. Respectueux de la monnaie nationale, les insurgés de la Commune épargnent le stock d'or de la Monnaie. Sa stabilité vaut même au franc germinal d'être adopté comme référence commune par de nombreux pays au sein de l'Union latine.
Dévalué après la Grande Guerre de 1914-1918, le franc germinal est remplacé par un franc au rabais, le «franc Poincaré», en 1928.
Le franc a perduré comme monnaie de référence de la France jusqu'au 31 décembre 2001, dernier jour avant l'euro. Il subsiste dans les anciennes colonies françaises d'Afrique et du Pacifique ainsi qu'en Suisse (vestige de l'Union latine).
BibliographieOn peut lire l'excellent ouvrage de vulgarisation, très complet, de Georges Valance : Histoire du franc, 1360-2002(Flammarion, 1996).
André Larané votre commentaire
votre commentaire
-
Saurez-vous percer le mystère de ces séries de Pères Noël et de flocons de neige colorés ? Entrez d'ores et déjà dans l'esprit des fêtes de fin d'année avec ces illusions d'optiques spécialement conçues pour l'occasion.
Où se trouve le Père Noël... avec la hotte pleine de billets ?

Où se trouve le Père Noël... avec la hotte pleine de billets ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Parmi ces flocons, lequel est différent des autres ?

Publié par Lambert Pecheux votre commentaire
votre commentaire
La Tigresse au coeur tendre







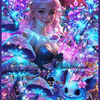













 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot









